Pour les moins de trente ans d’aujourd’hui
Pour les moins de trente ans d’aujourd’hui est un article de la revue Notre Temps. Pierre Brossolette tente de répondre à un papier de Marcel Prévost publié dans le Journal évoquant la révolte de la génération des jeunes du début des années 1930 contre sa devancière de 1920.
Pierre Brossolette, appartenant à cette dernière, tente de résumer quels ont été les idéaux de ses condisciples (le pacifisme, la SDN et la coopération internationale, la réconciliation des peuples après la guerre…) et les raisons de l’échec de leur mise en place. Pierre Brossolette lance en fait un défi à la nouvelle génération appelée à agir après la sienne.
Pour lire l’intégralité de l’article de Pierre Brossolette paru le 29 juillet 1993, Pour les moins de trente ans d’aujourd’hui, cliquez ici
Quelques extraits:
Gros sous
Je connais bien cette génération. J’en suis. J’ai participé profondément à sa vie, à son effort, à son espérance. Jean Luchaire a exalté ses mérites. Il n’ignore pas ses défauts. Je ne les ignore pas non plus. Et je ne serais pas disposé à les taire dans ce bref examen de conscience auquel il nous invite aujourd’hui. Je ne pousserai tout de même pas le masochisme jusqu’à les exagérer. Et franchement je ne crois pas qu’elle soit coupable de tous les crimes que lui impute M. Marcel Prévost, ni qu’elle mérite les reproches qu’il prête, contre elle, aux jeunes gens qui la suivent.
On ne peut pas caractériser cette génération en disant qu’elle a eu toutes les facilités et en l’accusant d’avoir pris toutes les places et de vouloir les garder.
D’abord ce n’est pas vrai. Notre génération n’a pas uniformément « réussi » au sens matériel où peut l’entendre M. Marcel Prévost. Elle a follement travaillé. Beaucoup d’entre nous ne se souviennent pas d’avoir, depuis 10 ans, pris beaucoup de repos. À de rares exceptions elle est rentrée dans la vie sans un sou. Avant la guerre (et déjà l’on peut constater un retour à ce bienfait), les familles, même de la plus petite bourgeoisie pouvaient aider financièrement les garçons au début de leur carrières, et le filles lors de leur mariage. Notre génération a eu le privilège de voir les revenus de ses parents diminués par la guerre et volatilisés par l’inflation. Elle a dû se débrouiller seule. Elle a profité, certes, du grand vide creusé dans toutes les carrières par la mort d’un million et demi de soldats. Elle le sait. Elle sait aussi qu’elle a compensé cette ascension rapide par des charges énormes et joyeusement consenties. Jamais les hommes ne se sont mariés aussi jeunes qu’au lendemain de la guerre. Jamais ils n’ont fondé, si jeunes, des foyers dont la charge pèse sur eux même lorsque le mariage a fini par une séparation. Il y a eu, dans notre cas, plus d’aventure, plus de risque que chez les générations d’avant la guerre et que chez la génération qui nous suit, il y a eu plus de succès rapides; mais aussi plus d’accidents, plus d’échecs amers, plus de déceptions. Les faillites ont compensé — et expié — les départs foudroyants.
Laissons d’ailleurs ces questions matérielles. Elles comptent, certes, et je dirai tout à l’heure qu’il serait criminel de ne pas aider la jeunesse, au cas où se prolongerait la passe difficile dans laquelle elle se débat et dont le décret Chéron est l’éclatant symbole. Elles ne sont pourtant pas tout. Elles ne sont même pas l’essentiel. Ce que les générations se reprochent le plus volontiers, ce n’est pas leur succès, mais leur esprit. Si les jeunes critiquent quelque chose chez ceux de leurs aînés qui sont « arrivés », ce n’est pas leur arrivée mais leur arrivisme. Parce que cette génération, en se proclamant « réaliste », s’est elle-même exposée aux inconvénients d’une amphibologie malheureuse, ils la croient peut-être égoïste, matérialiste et prête à barrer la route après l’avoir ouverte. Problème moral qui domine le problème matériel.
Nous avons essayé
Il y a trois ans, dans le numéro spécial que Notre Temps a consacré à 1830-1930, j’avais déjà eu l’occasion de dire que telle n’était pas la génération d’après-guerre pour peu qu’on veuille bien dépasser les apparences et pénétrer jusqu’à la vie profonde qui s’est cachée derrière son allure positive et conquérante. Les échos que j’ai recueillis de cette étude m’ont prouvé que je ne m’étais pas trompé. Cette génération a été ardente, et elle a été malheureuse. Ce qui l’a marquée, c’est d’avoir ouvert les yeux sur un monde en folie. Elle n’a pas connu l’avant-guerre, avec ses certitudes trompeuses, sa foi dans le progrès, son intellectualisme tranquille et sa morale toute faite. Dès que nous avons regardé autour de nous, c’est le plus effroyable gâchis que nous avons vu: la guerre, avec ses vies sacrifiées, ses souffrances mortelles, ses mensonges, sa haine et sa férocité; la paix, avec son absurdité, sa violence et ses rodomontades patriotiques; l’après-guerre, avec ses appétits, ses combines et sa médiocrité. Nous avons enveloppé dans une même aversion le nationalisme et le pacifisme d’avant-guerre, qui ont fait faillite le 2 août 1914, la morale christiano-kantienne au nom de laquelle on s’est massacré pendant cinq ans, l’héroïsme qui a alimenté la guerre et la platitude d’une vie quotidienne, le jour où chacun n’a plus eu que des soucis domestiques ou personnels, la littérature fleurie d’Anatole France et de Barrés, et le vocabulaire grotesque de la « république démocratique et sociale »: « Honneur, patrie, humanité, progrès et vérité en marche. »
Nous sommes entrés dans la vie à un moment où la mort seule avait de la grandeur, mais où elle était absurde.
…
Peut-être, à certains moments, avec plus ou moins d’optimisme, avons-nous pu croire que nous avions réussi — au moins par personnes interposées. Les élections de 1924 ont été l’un de ces moments. Puis Locarno. Puis le règne incontesté de Briand sur l’opinion française. Nous voici maintenant en 1933. Et tout s’est écroulé. Le mot international et le mot socialisme suffisent à provoquer les rires. Les Internationales se dissolvent, la SDN est morte, l’Union européenne est une dérision et le désarmement une blague. L’autarcie est devenue le dogme d’un monde économique où l’on ne parle plus que de barrières douanières, de contingentements et de bataille monétaire. L’Allemagne est plus loin que jamais de la France. Partout une extraordinaire marée nationaliste a submergé les peuples. Les masses ne répondent plus qu’à l’appel national. Les « Français, garde à vous » font écho aux « Allemagne, réveille-toi ». Et les seules doctrines qui agissent aujourd’hui sur les foules sont juste celles qui s’opposent le plus directement aux nôtres, puisque les fascismes mêlent exactement ce dont nous ne voulons point : le nationalisme et l’oppression des travailleurs devant l’État capitaliste.
C’est donc fini pour le moment.
Nous sommes battus.
Et si les jeunes nous reprochent de trop rapides succès, ils se trompent. Ce dont nous leur devons compte, c’est de notre défaite.
Nous aurions mauvaise grâce à dire que si nous avons échoué, ce n’est pas notre faute. On a toujours tort d’être vaincus. Pourtant nous ne nous croyons coupables ni de lâcheté, ni d’erreur. Nous nous sommes battus tant que nous avons pu, et nous sommes prêts à continuer. Nous avons cru à notre idéal, et nous y croyons encore. Au lendemain du triomphe fasciste en Italie, en Allemagne, en Autriche, à la veille, peut-être, d’un triomphe analogue chez nous, nous croyons encore que l’internationalisme est supérieur au nationalisme, et que le socialisme est supérieur au capitalisme, même quand ce capitalisme est d’État. Et toujours nous le croirons — ou nous ne croirons rien.
Non, nous n’avons pas été battus par la mollesse de notre effort ou par le vice de nos idées. Nous avons été battus par les vieillards et parce que le gouvernement de ce pays a été laissé aux vieillards.
…
C’est ainsi qu’au lieu d’une génération triomphante, nous sommes une génération battue. En 1830, les romantiques avaient vaincu. Lorsqu’ils mettaient des gilets rouges, c’étaient les autres qui étaient ridicules. Les risques seraient retournés si nous nous avisions d’en arborer. Nous n’avons pas droit à l’arrogance.
La jeunesse veut manger
Nous voici maintenant devant les jeunes. Ils ont le droit de nous juger. Nous acceptons leurs reproches. Mais aussi nous les interrogeons. Que veulent-ils ? Qu’ont-ils à nous proposer, qu’ont-ils à demander, à la place de ce que nous avons voulu — et manqué ?
Rendons-leur cet hommage : ils sont discrets. On entend peu leurs voix.
…
Ce qu’on distingue le mieux dans son murmure, c’est l’inquiétude de ne pas trouver de travail et de pain. Cette crainte est même ce qui peut en partie expliquer son silence et son apathie. La crise a fermé bien des portes.
…
D’autres mesures pourront résoudre le chômage qui menace la jeunesse: la semaine de quarante heures, la retraite ouvrière à cinquante-cinq ans, l’orientation professionnelle. Jusqu’à ce que les jeunes gens aient créé des groupements neufs et puissants, c’est encore sur les anciens qu’ils doivent compter. Et c’est aussi sur nous, qui avons les premiers proclamé (je l’ai moi-même fait ici bien avant la crise) la nécessité de ces mesures et qui luttons pour elles.
…
La jeunesse veut-elle aussi penser?
Nous nous tournons avec angoisse vers la génération qui nous suit. Nous voudrions l’entendre bouger, crier, affirmer. Nos déceptions nous ont fait douter de nous-mêmes. Nous sommes prêts à accepter de nos cadets des impulsions, des mots d’ordre, des mystiques. Nous n’entendons pas jouer en face d’elle le rôle qu’ont joué, en face de nous, trop de nos pères. Nous ne voulons ni lui proposer, ni lui imposer des formules dont elle ne voudrait pas. Nous l’écoutons.
Que veut-elle ? Borne-t-elle son ambition à de tranquilles situations dans les ministères et dans les administrations ? A-t-elle pour idéal celui que Guizot donnait à nos arrière-grands-pères en leur disant « Enrichissez-vous » ? Et n’a-t-elle pour seul regret que celui de voir cet enrichissement ne pas arriver assez vite ? S’il en est ainsi, tant pis. Nous ne lui refuserons pas la place que méritent ces modestes visées. Mais qu’elle ne compte pas sur nous pour nous intéresser à son avancement et à ses décorations. Ces préoccupations comptaient trop peu pendant la guerre pour compter beaucoup à nos yeux aujourd’hui.
…
Ils ne veulent pas revenir au passé. Ils veulent le secouer et construire un monde nouveau, comme nous-mêmes nous avons rêvé de le faire, et comme nous n’y sommes pas parvenus. La république ne les intéresse point, parce qu’elle n’est qu’un trompe-l’œil. Ils ne croient plus à la réforme, parce qu’elle est trop lente, qu’elle entraîne trop de compromissions, et qu’elle est trop aisément révoquée lorsque l’argent vient à manquer. Ils ne croient pas plus à l’insurrection. Voici trop longtemps qu’on la leur promet, et, au moment de la déclencher, on sent bien qu’elle ne peut conduire qu’à une inutile boucherie, à la défaite, et à la dictature de l’adversaire. Pendant une guerre, peut-être serait-elle possible ? Ce n’est pas sûr. Et d’ailleurs qui d’entre nous, qui d’entre les adolescents pourrait pousser l’abstraction assez loin pour souhaiter, au profit d’une incertaine émeute, une guerre où s’engloutirait certainement tout ce qui a pu échapper à la dernière ?
Alors ? Que veut la jeunesse ?
…
La jeunesse est ainsi bien plus libre que nous de revenir à l’humain, à l’individuel. Exalter la personne humaine, lui rendre sa valeur et son sens, rendre à chacun l’idée de sa grandeur, la notion de sa capacité de sentir et de souffrir, réhabiliter le cœur, peut-être est-ce là la mission de la jeune génération. S’exposer à moins de déceptions en cessant de voir dans l’économie collective et la paix organisée des buts logiques et absolus dont l’échec désespère. Voir seulement en elles les conditions les plus favorables, mais les plus difficilement accessibles, de la vie individuelle, de la défense de l’individu. Maintenir, même sous des régimes hostiles et même au milieu des désastres, cette primauté de la vie spirituelle: voilà peut-être ce que peut faire la jeune génération. C’est le contraire du fascisme. C’est le contraire aussi du libéralisme bourgeois dont la jeunesse a horreur comme nous. Et si c’est, d’apparence, différent de ce que nous avons cru et tenté pendant dix ans, le pont du moins est aisé à lancer. Car si le retour humain condamne nos formules, il est possible qu’il rejoigne au fond les mobiles secrets — les mobiles que nous n’avons pas avoués, que nous ne nous sommes pas avoués à nous-mêmes — d’une action que nous avons crue réaliste et qui, peut-être, était surtout généreuse.
Pour lire l’intégralité de l’article de Pierre Brossolette paru le 29 juillet 1993 « Pour les moins de trente ans d’aujourd’hui »: cliquez sur le lien suivant
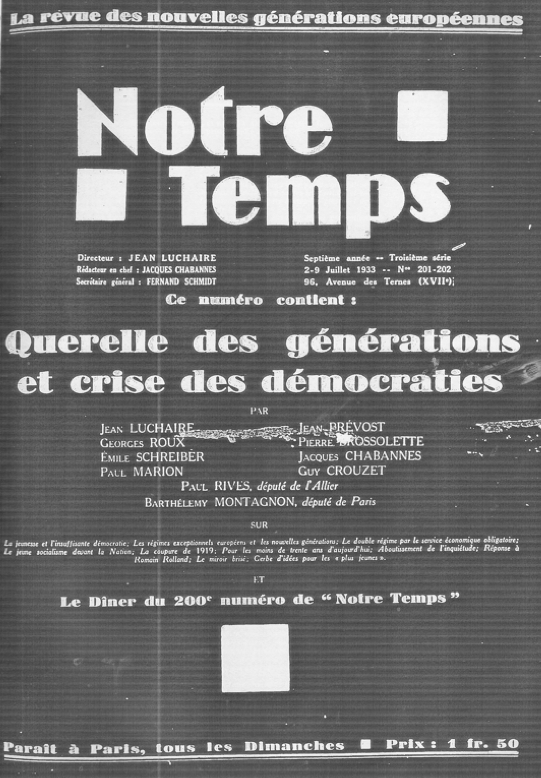
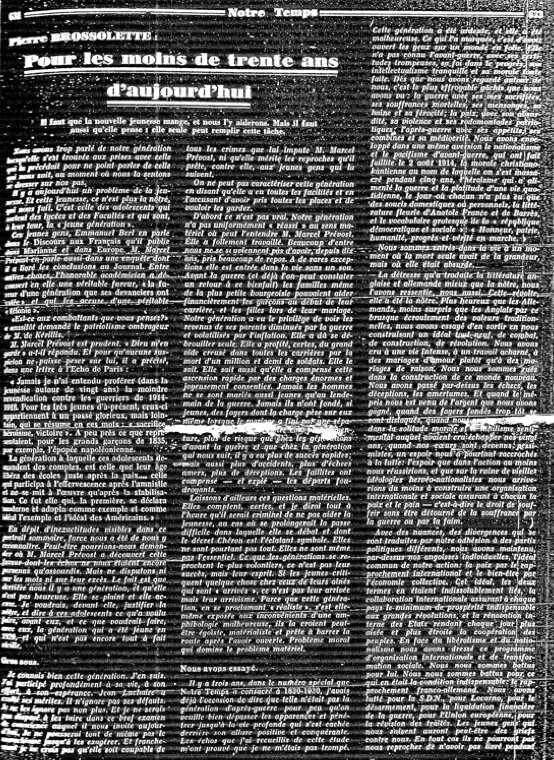



![[Article] Les États-Unis de l’Europe … en 1927 !](https://www.pierrebrossolette.com/wp-content/uploads/2013/08/otre-temps-500x383.png)
