PIERRE BROSSOLETTE – Héros de la Résistance , René OZOUF. Clamart. le 15 Février 1946
Héros de la Résistance
Un brillant élève
Pierre Brossolette naquit le 25 juin 1903 à Paris, dans le quartier d’Auteuil alors encore paisible et quasi-rustique. Son père, Léon Brossolette, était issu d’une modeste famille paysanne de la région d’Ervy-le-Châtel, entre Champagne et Bourgogne. Il avait préparé à sa petite école de canton le concours de l’École Normale primaire de Troyes ; puis, seul, le concours de Saint-Cloud. En 1903, il était professeur à l’École Normale d’Instituteurs d’Auteuil, avant de devenir, en 1913 et jusqu’à sa retraite, Inspecteur de l’Enseignement Primaire de la Seine. De ce père, Pierre avait hérité son inflexible ténacité, sa rectitude de jugement, son total désintéressement, et ce courage, si difficile, de ne jamais mentir à ses convictions, de ne jamais transiger avec ce qu’il jugeait juste et vrai, de dire, lorsqu’il le fallait, toute sa pensée quoi qu’il pût lui en coûter.
Sa mère, Jeanne Vial, appartenait à une lignée dauphinoise, terrienne elle aussi, mais qui avait déjà donné une génération à l’Enseignement ; l’oncle de Pierre, Francisque Vial, devait, de son côté, achever sa carrière universitaire comme Directeur de l’Enseignement secondaire. Pierre tenait de sa mère cette vive sensibilité qui se révélait dans le côté artiste de sa nature comme aussi dans ce profond sentiment de fraternité qui le mettait spontanément en communion avec les humbles. De sa mère encore, il reçut ce don de séduction qui tempérait l’intransigeance de son caractère, ce sourire des longs yeux bruns, cette vie du visage, ce charme auquel nul n’échappait de ceux qui l’approchaient, fussent-ils même en opposition avec lui.
Deux sœurs aînées, une cousine : il était le premier garçon de la famille, mais n’en fut nullement gâté pour cela. Des principes stricts, une discipline ferme, présidaient à l’éducation familiale et aucune concession n’était faite aux petites faiblesses et aux caprices enfantins. Mais l’atmosphère, au foyer, était chaude d’affection, et ses deux sœurs, de quelques années plus âgées, adoraient leur jeune frère, qu’elles entouraient de sollicitude.
Le petit Pierre fréquenta d’abord l’école annexe de l’École Normale, rue Boileau. Ses camarades ont gardé le souvenir du petit bonhomme au visage rond sous le béret marin, au tablier noir strictement serré par la ceinture de cuir et que la coquetterie maternelle éclairait d’un col blanc.
Nous avons eu entre les mains la fiche qu’un élève-maître dressa en 1911 sur l’enfant qui, âgé de sept ans et demi, suivait la classe de première année de cours moyen avec des camarades dont l’âge moyen était de neuf ans. » Lorsque j’ai interrogé le petit Brossolette, y est-il dit, j’ai toujours été frappé par la netteté et la justesse de ses réponses. Cela vient de ce que cet enfant a déjà un jugement sûr, clair et précis en raison d’un certain bon sens naturel et aussi de ses connaissances acquises en lisant, – car il lit beaucoup. Il ne se borne jamais à répéter ce qu’il a entendu ; il veut tout d’abord comprendre ce qui lui a été enseigné ; ensuite il exprime son jugement, souvent d’une manière originale. » Et plus loin : » Brossolette est patient et réfléchi… Contrairement à la plupart de ses camarades, il cherche avant de répondre et tient à faire une réponse juste et sensée… « .
En octobre 1913, il entre au Lycée Janson-de-Sailly. L’hiver suivant, il perd sa mère, et l’atmosphère de la maison en est cruellement assombrie.
La grande guerre qui survint alors fut pour lui une autre épreuve. Les épisodes tragiques de la lutte trouvaient en Léon Brossolette, historien par inclination, un observateur clairvoyant qui ne se laissait jamais bercer aux mensonges rassurants des littératures officielles et découvrait, entre les lignes des communiqués et à l’examen de la carte, les vérités pénibles qu’on s’efforçait trop souvent de cacher au public. Et, sur son visage silencieux, à certains tournants de la guerre, se reflétait l’extrême gravité de la situation. Son fils apprenait, par son exemple, à ne jamais accepter les illusions qui masquent la dureté des faits, à chercher avant tout la vérité, pour y faire face. Un quart de siècle plus tard, Pierre abordera, avec la même lucidité, une réalité plus tragique encore, mesurera sans faiblesse l’abîme où la France est tombée et les difficultés et les dangers de la situation et, à sa manière, y fera face.
Pour l’instant, au mois d’août 1914, dans la capitale où son père est retenu par ses fonctions, il vit les douloureuses semaines de l’invasion, de la ruée allemande vers Paris. Déjà, il voit à la Porte d’Auteuil, dérisoires chevaux de frise, les arbres abattus, leurs branchages tournés vers l’extérieur comme une suprême défense contre un raid surprise de l’ennemi. L’idée d’un siège ne lui fait pas peur, mais brusquement, son père, soucieux de ses responsabilités, décide de l’envoyer avec ses deux sœurs en province. Malgré leurs protestations, les trois enfants quittent Paris par le dernier train formé à la gare P.L.M., long convoi de wagons à bestiaux, qui se dirige vers Lyon par des voies détournées, en un voyage interminable. La victoire de la Marne leur permet de regagner la capitale à la rentrée d’octobre, mais l’enfant gardera le souvenir de ce premier exode.
Au Lycée Janson de Sailly, Pierre Brossolette se range tout de suite parmi les bons élèves de sa classe et obtient bientôt régulièrement le Prix d’Excellence. Il consacre d’autre part au violon, pour lequel il est très doué, une grande partie de ses loisirs et la musique devient la distraction favorite de sa vie que le poids de la guerre et aussi l’atmosphère de labeur de son foyer rendent bien austère pour un garçon de treize ans.
A dix-sept ans, muni de son baccalauréat, il entre en » Khâgne » à Louis-le-Grand, où il trouve une brillante équipe de professeurs, les Bernès, les Roubaud, les Bellessort… En 1922, il passe la Licence ès Lettres. Le même été, affrontant pour la première fois le concours, il est reçu à dix-neuf ans avec le n° 1, à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm. Malgré les instances du directeur, M. Lanson, qui souhaitait que le major de la promotion préparât l’agrégation des Lettres, Pierre Brossolette opta pour l’Histoire et, après trois années d’études durant lesquelles il passa avec succès la licence en Droit, le voici agrégé d’Histoire en 1925, à vingt-deux ans. Ses maîtres, Charles Diehl, Guignebert… l’encouragent à poursuivre ses études historiques, mais s’il a ardemment travaillé dans les livres jusque-là, il se sent avant tout la passion d’agir.
Une vocation politique
Après une année de service militaire, il se tourne vers le journalisme et la politique. Il vient d’épouser une jeune fille rencontrée à la Sorbonne au cours du professeur Demangeon. Ils ont, à eux deux, quarante-trois ans.
Pierre collabore successivement et parfois simultanément au Quotidien, à Excelsior, à Marianne, à l’Europe Nouvelle où il traite plus spécialement des problèmes de politique étrangère. Des hommes politiques illustres, ministres ou parlementaires, appartenant aux tendances les plus diverses, s’efforcent de se l’attacher afin d’utiliser des dons qu’ils sentent exceptionnels. Mais il refuse de s’inféoder à quiconque. En 1928, il adhère au parti socialiste, dont il partage le noble idéal : c’est une politique de démocratie et de progrès social qu’il entend poursuivre. Une politique de paix aussi : il met ses espoirs dans la Société des Nations et fait à travers la France de nombreuses conférences de propagande pour la grande institution de Genève que d’aucuns s’attachent à discréditer.
L’avènement de l’hitlérisme en Allemagne va orienter son action vers une politique étrangère faite de lucidité et d’énergie car il n’est pas de ceux chez qui le pacifisme obnubile le sens national. Il sent bien vite que la cause de la liberté et l’indépendance de la France sont également menacées. Avec beaucoup de clairvoyance, il dénonce les manœuvres tortueuses du nazisme en France et dans le monde. Appelé à faire dans le Radio-Journal de France, à Paris P.T.T., la Journée dans le monde, il souligne avec force l’intervention italo-allemande en Espagne et montre que les événements qui ensanglantent la péninsule ibérique sont beaucoup moins une affaire de politique intérieure qu’une offensive camouflée de l’Axe contre la République espagnole et contre les puissances démocratiques. Ses chroniques de politique étrangère radiodiffusées, très remarquées en France et à l’étranger, lui valurent alors les attaques et les violentes menaces de ceux qui formaient déjà la cinquième colonne. Les disques sur lesquels ces bulletins étaient chaque jour enregistrés, ont malheureusement été détruits pour la plupart en 1943 sur l’ordre du gouvernement de Vichy.
M. Robert Jardillier, qui l’avait désigné pour occuper ce poste à la Radio, commente ainsi ces attaques à propos des événements d’Espagne, » ballon d’essai du nazisme impérialiste » : » Brossolette avait la certitude que la victoire de Franco ne serait pour les dictatures qu’un prélude. Et il le disait avec une netteté qui savait être coupante quand il le fallait. D’où les haines des futurs collaborateurs. Ils répondaient à ces démonstrations par les plus indigestes plaisanteries. Se souvient-on de la » Brossolette à reluire » inventée par les » cerveaux » de l’Ami du Peuple. Ils le sapaient sans arrêt. Ils obtenaient en 1938 sa mutation. Mais qu’importait ? Brossolette avait déjà démontré ce qu’il saurait être : celui qui ne recule jamais. «
À la demande de Léon Blum qui sent monter le péril, lui aussi, il a accepté, toujours en 1938, de rédiger la chronique quotidienne de politique extérieure du Populaire et, lors des événements de septembre suivant, il combat de toutes ses forces l’abdication munichoise et prédit qu’elle ne nous épargnera pas la guerre.
Dans le Populaire du 30 septembre 1944, Roger Gui bien évoque ainsi l’activité du jeune journaliste : » Londres… Genève… New-York… Bucarest… Changhaï… Varsovie… Prague… Berchtesgaden… Le » printing » crépite et déroule son rouleau de papier blanc dont un rédacteur arrache les fragments. Les télégrammes multicolores, transmis par le » central « , se succèdent. Les sténographes apportent, hâtivement transcrites, les informations téléphonées par fil spécial. Tout cela s’amoncelle sur la table de Pierre Brossolette.
» Brun, tel un conquistador, l’œil noir, une mèche blanche soutachant ses cheveux d’ébène, le visage aux traits accusés à peine plus marqué par l’effort d’attention, il parcourt rapidement tous ces feuillets, souligne les uns d’un trait de crayon et les passe à ses aides, jette les autres au panier, réserve les derniers pour son prochain article. Car ce communiqué minutieux cache une origine suspecte ; ce long compte-rendu vaut un entrefilet de dix lignes ; cette note brève, impénétrable au profane, met en jeu la paix de l’Europe. Il sait tout cela. Brossolette a choisi, dans le journalisme, la rubrique de la politique étrangère, délicate, difficile, ingrate entre toutes. Il y est passé maître.
» Ses lectures ? Les » livres bleus « , les » livres blancs « , les » livres jaunes « , que les gouvernements publient dans les périodes de crise, les mémoires des diplomates, les commentaires des hommes d’État. S’il se déplace, c’est pour suivre quelque conférence internationale. Et il emploie ses vacances à visiter les capitales dont les noms reviennent chaque jour sous sa plume. Aussi ces mots au sens souvent obscur s’éclairent-ils pour lui d’un attrait particulier. A travers eux, il aperçoit le réflexe familier de tel premier ministre et la menace encore imprécise qu’ébauchent les intrigues de tel lointain pays. Cette fièvre lucide, cette immobilité qui résume le mouvement du vaste monde, c’est la part qu’il a voulue. Mais les destins en ont décidé autrement… «
Citons encore ces paroles d’un autre de ses camarades d’alors : » Je revois son sourire un peu triste, sa figure aiguë, ses cheveux lisses, son regard tour à tour passionné ou méprisant. Nourri d’humanités, l’esprit toujours alerté sur la fine pointe de la critique, c’était seulement par éclats, comme un feu éclairant, qu’il laissait échapper cette indignation qui trahissait une foi sans cesse refoulée. C’était aux jours sombres de Munich. Il ne s’était pas laissé prendre aux apparences trop consolantes d’une paix qui mentait tous les jours davantage. » Dans un an, tu verras « , m’avait-il dit, avec une rage contenue. Et depuis ce jour-là, chaque dépêche, chaque événement lui donnèrent raison, en amenant le monde vers cet abîme où il se débat encore.
» C’est que ce prophète averti était un parfait démocrate. Il n’en démordait pas sur le chapitre de la pensée libre. Les coups de botte nazis frappant les pavés de Prague, le triomphe de Franco, les coups de poignard fascistes, chaque atteinte à la liberté d’un peuple ou à la vie d’un homme le frappait lui-même au cœur et rendait encore plus pâle son maigre visage déjà si pâle. Il avait l’âme d’un partisan et l’esprit d’un militant. Nous ne savions pas encore qu’il avait le cœur d’un héros.
» Tout nous semblait alors impossible, entraînés que nous étions dans un courant d’aveugle démagogie, de compromissions et de lâches acceptations. Je me souviens d’un jour où les journaux ayant réservé une place à je ne sais quel scandale bien parisien, tandis que la guerre rôdait aux quatre coins de l’Europe, il éclata de fureur :
» – Les imbéciles, me dit-il, tout va s’écrouler et voilà de quoi ils s’occupent ! «
Confrontation avec la Guerre
Mobilisé le 23 août 1939, il part comme lieutenant au 5e Régiment d’Infanterie (21e Bataillon), corps où il avait déjà été rappelé une première fois pour quelques semaines en mars, au moment des événements de Tchécoslovaquie. Il prend alors le commandement de la Compagnie d’Accompagnement du Bataillon à la tête de laquelle il gagne la zone des armées. Très rapidement, grâce à ses qualités d’organisation et d’initiative, grâce aussi à la façon dont il sait adapter les règlements militaires aux circonstances tout en en conservant l’esprit, grâce enfin à sa manière » humaine » d’exercer le commandement, il acquiert une exceptionnelle autorité. Il paie de sa personne, il est vrai, passant tout le jour au milieu de ses hommes, perfectionnant leur installation matérielle, en même temps que leur instruction militaire, partageant leurs préoccupations et leur témoignant une sympathie telle qu’il devient rapidement populaire et que sa compagnie parfaitement disciplinée et entraînée est connue au Corps comme » la Compagnie qui marche « .
En raison sans doute de ses opinions politiques, il est d’abord accueilli avec une certaine réserve qui cache une hostilité de principe par certains officiers de son groupe ou des formations voisines pour lesquels » socialiste » ne peut qu’être synonyme d’antipatriote et d’antimilitariste. Mais il conquiert bien vite ceux qui l’approchent par sa haute culture, sa probité intellectuelle, son sens national aigu et aussi par sa conscience professionnelle que beaucoup des officiers de carrière qui l’entourent pourraient envier.
Au début de 1940, lors de la visite médicale des officiers, le médecin du corps veut le faire classer » inapte à faire campagne » en raison d’une maladie de foie qui se manifeste par des crises fréquentes et douloureuses. Mais il n’entend pas être affecté à une formation de l’intérieur et à sa demande formelle, il est maintenu dans une unité combattante.
Peu après, il est volontaire pour partir en Norvège, mais il n’obtient pas satisfaction étant un des plus anciens lieutenants alors qu’on entend choisir parmi les plus jeunes.
En avril 1940, il est nommé capitaine au choix et sa promotion est accueillie par tous avec faveur.
Le 22 mai, à la suite de l’offensive éclair des Panzer Divisions, la situation devient critique et k bataillon de Pierre Brossolette caserné jusque-là à la Ferté-sous-Jouarre, reçoit l’ordre de prendre position pour la défense du pont de la Marne. Le 13 juin, après de rudes combats, prolonger la résistance s’avère inutile par suite du décrochage des unités voisines. Les Allemands ont d’ailleurs passé la Marne en amont de la Ferté et s’avancent en masse.
Après un sévère bombardement, la retraite commence à travers la Brie et le Gâtinais, par des routes encombrées de véhicules militaires, de soldats isolés et de la cohue lamentable des réfugiés qui fuient. Au milieu de la débâcle, le capitaine Brossolette conserve son sang-froid, sa préoccupation essentielle est de sauver sa compagnie. » Son courage physique et sa volonté, écrit un de ses camarades, font l’admiration de tous. Rompu de fatigue, les pieds ensanglantés par des marches interminables qui vont jusqu’à atteindre cent kilomètres en quarante-huit heures, il refuse, pour ne pas abandonner ses hommes, d’utiliser la bicyclette qu’on lui propose. Il entend prêcher d’exemple et réussit à garder son unité groupée autour de lui, contribuant en outre pour une large part à maintenir la cohésion du bataillon dont le chef a été évacué. » Ses hommes ont tout perdu mais – exception remarquable dans cette débâcle – ont gardé leurs armes et on les vit avec étonnement défiler en ordre avec leurs fusils.
A Sully-sur-Loire, le 16 juin, le pont routier a été rendu impraticable par bombardement aérien. En pleine nuit, à la lueur sinistre des incendies, le capitaine Brossolette fait emprunter à sa troupe le viaduc du chemin de fer encombré de civils et dont il faut avec des planches boucher la brèche faite au milieu du tablier par une bombe. La compagnie passe, puis, malgré l’absence de toute liaison avec les éléments voisins et un épuisement quasi-total, continue son repli vers le Cher et la Vienne. Brossolette entend qu’aucun de ses hommes ne soit prisonnier. La nouvelle de la cessation des hostilités parvient à la compagnie le 25 juin, alors que toujours aux ordres du commandement, elle venait de prendre position pour défendre le passage de la Vienne, dans la région de Limoges. Cette belle conduite pendant la retraite vaut à l’ensemble du Bataillon une citation à l’ordre du régiment pour avoir fait preuve » d’endurance, de discipline et de mépris du danger « . Le capitaine Brossolette est décoré personnellement de la Croix de Guerre, – croix qui devait plus tard lui être retirée par Vichy. Fin août 1940, à Saint-Saud-Lacaussière (Dordogne), il réalise la démobilisation totale de sa compagnie puis est à son tour rendu à la vie civile.
Un volontaire de la Résistance
Pendant la débâcle, Pierre Brossolette a entendu, le 18 juin, l’appel pathétique lancé de Londres par le général de Gaulle. Il en a été fort ému et son premier réflexe a été de partir coûte que coûte Outre-Manche pour rejoindre les forces de la France libre. Mais il n’a pu se résoudre à abandonner ses hommes. La retraite n’était pas encore parvenue à son terme ; il restait, sinon à combattre du moins à rallier, à ordonner. Pierre Brossolette avait tenu à accomplir sa tâche jusqu’au bout. Il est maintenant trop tard pour gagner Londres directement. Il passe par Vichy où quelques heures lui suffisent pour être fixé sur les véritables sentiments du maréchal et de son entourage. Le spectacle dont il est le témoin et la mentalité qu’il perçoit, si camouflée qu’elle soit, ne lui valent qu’un haut-le-cœur. Il fuit ce » panier de crabes » et rentre à Paris, dans ce Paris » occupé » où paradent et règnent les vainqueurs.
Sa femme et ses enfants ne sont pas encore revenus de province. En ce début de septembre où le fracas des gros avions allemands qui partent bombarder l’Angleterre, emplit nuit et jour le ciel de Paris, il va souvent à Clamart chez sa sœur et son beau-frère : de quoi parlerait-on sinon de la honte présente, des chances de relèvement, des espoirs vivaces qui restent aux cœurs ? L’Angleterre tiendra et les Français se réveilleront… Quand il repart, le pied sur la pédale de sa bicyclette, les yeux brillants et un sourire aux lèvres, il dit à mi-voix : » Et puis, de Gaulle n’est pas mort ! «
Mais il faut vivre. Pierre Brossolette ne saurait avilir sa plume en la mettant au service des journaux allemands de la capitale qui lui font pourtant des offres mirifiques. Sans se faire beaucoup d’illusions, car il sait les sentiments des autorités vichyssoises à son égard. il sollicite un emploi dans l’enseignement. Bien entendu, aucune réponse ne lui est faite. Il se tourne alors vers d’autres occupations qu’il sait provisoires, songe à acheter un hôtel, une chemiserie, puis finalement, en octobre 1940, acquiert une petite librairie, rue de la Pompe, non loin du Lycée Janson de Sailly, dont il a été l’élève quelque vingt ans plus tôt. Le voici qui vend des crayons, des gommes, des stylos, qui court les magasins des éditeurs pour se procurer de la marchandise, qui, dans le choix des livres, guide des clients que surprennent la compétence et l’aisance du libraire, qui sourit de l’ingénuité de certains, s’amuse de l’ignorance ou de la prétention des autres… Pour le distraire d’un mercantilisme facile et qui permet de vivre, certes ! mais si éloigné de ses aspirations et de ses rêves d’hier, il donne des cours d’histoire contemporaine aux jeunes filles du Collège Sévigné dans un esprit qui, on le pense, ne saurait être celui de la Révolution dite Nationale. De son père, n’a-t-il pas hérité un jacobinisme qui le rend intransigeant pour tout ce qui touche à l’indépendance de la Patrie et au salut de la République ?
Ce même sentiment le pousse à entrer sans tarder dans la Résistance active. Pierre Brossolette qui avait voulu passionnément la paix, avait aussi signalé le danger, prévu le conflit et stigmatisé ceux qui conduisaient la France à sa perte. Comme son ami André Philip qu’il rencontre quelques mois plus tard à Lyon, il se range immédiatement parmi ces Résistants de la première heure, » des hommes qui croyaient suffisamment en la liberté pour lui être fidèles, même quand elle était foulée aux pieds, ridiculisée, vilipendée par tous, qui croyaient suffisamment à la vérité pour vouloir lui rendre témoignage, même quand on se moquait d’elle partout, des hommes fidèles à ce qui est vraiment le centre et la définition même de notre civilisation française, ce respect profond de la personne humaine, et la liberté qui en découle et les qualités de droit de tous les êtres humains devant la loi. » Nous avions tous le sentiment, ajoute André Philip, qu’il y avait là un patrimoine que nous devions défendre, que nous devions maintenir, quand bien même la lutte dût continuer pendant des décades et des décades sans espoir.
Dès septembre 1940, Brossolette écrit dans des journaux clandestins dactylographiés, nés dans une arrière boutique de la rue Bonaparte et qui circulent sous le manteau.
Puis, au cours de l’hiver 1940-1941, et par l’intermédiaire de Madeleine Le Verrier, ancienne directrice de l’Europe Nouvelle, il entre en rapport avec le groupe de résistance du » Musée de l’Homme » dont font partie Jean Cassou, Claude Aveline, Marcel Abraham, Jean Aubier, Jean Duval, Christiane Desroches, Agnès Humbert. Ce groupe publie un journal, Résistance, tiré sur la ronéo du Musée de l’Homme mise à sa disposition par le docteur Rivet. Après l’arrestation de Nordmann et de Lewitzky, Brossolette accepte de devenir » rédacteur en chef » de Résistance.
Au cours d’une réunion, un camarade apporte des précisions au sujet de l’arrivage à Marseille de la morue pêchée à Terre-Neuve par nos marins. La morue a été immédiatement expédiée en Allemagne par trois trains spéciaux. Les deux premiers ont pu partir, mais le bon peuple de Marseille empêche le départ du troisième et la morue qu’il contenait est distribuée dans la ville par les pilleurs eux-mêmes. Brossolette rédige sur ces incidents un article nourri de détails truculents destiné au numéro de Résistance du 1er avril 1941. Agnès Humbert chez qui ce numéro est confectionné avec Jean Cassou, tape l’article à la machine et brûle le manuscrit de Pierre dans sa cheminée. Mais il s’agissait d’un papier de cahier d’écolier très résistant : carbonisé il a gardé sa forme. Les deux officiers (le la Gestapo venus perquisitionner chez Agnès Humbert après l’arrestation de celle-ci, le 15 avril 1941, le découvrent et s’en emparent : mais il tombe en cendres entre leurs mains…
Pierre n’échappe toutefois à la Gestapo que de justesse. Ici, laissons la parole à Agnès Humbert : On me » cuisine » pendant six heures, rue des Saussaies… La Gestapo a été prévenue de nos réunions chez Jean Duval, 30, rue Monsieur-le-Prince. Un de nos camarades arrêté a dû avouer sous la torture… Je nie. Le capitaine instructeur donne l’ordre de me conduire avec le camarade qui a parlé devant la maison de mes amis (que je jure naturellement ne pas connaître). Je me rends compte alors que nous sommes mardi, qu’il est six heures. C’est le jour et l’heure de notre réunion chez les Duval. Tous nos amis sont chez eux. Je fais comprendre au camarade qui m’accompagne que j’ai nié. On arrête la voiture au coin de la rue de Vaugirard et de la rue Monsieur-le-Prince. Le chauffeur me regarde dans son rétroviseur: un policier me dévisage tandis que l’autre accompagne mon camarade devant la maison des Duval. Je prends un air détaché, indifférent… Je pense à Brossolette qui est là-haut et qui dit à chaque coup de sonnette :
– » Vingt-deux ! Voilà les Fritz ! «
Cette fois, il va encore dire la même chose et ce ne sera pas une plaisanterie !…
» Je ne saurai jamais ce qui s’est passé… Le camarade a probablement nié…, s’est rétracté peut-être… Nous n’étions qu’en 1941, la Gestapo hésitait à fouiller une maison entière, d’autant plus que personne ne connaissait le nom des Duval… et manifestement on ignorait l’étage de l’appartement. De plus, la concierge était, à cette époque, toujours absente l’après-midi… Après quelques minutes, le policier est revenu avec mon camarade et nous sommes partis au Cherche-Midi. J’ai su depuis que les amis, au grand complet, m’attendaient chez les Duval… «
Après la dispersion du groupe du Musée de l’Homme, décimé par les arrestations, Pierre Brossolette poursuivit ses propres contacts avec divers mouvements de Résistance de la zone nord. Dès cette époque, il a l’idée d’entreprendre une grande action concertée, la seule, à son avis, qui puisse mener efficacement et rapidement au but : la délivrance ! Le système des petits groupes agissant isolément, des cellules dispersées incapables de coordonner leurs efforts lui semble inopérant et de nature à dépenser en pure perte de précieuses énergies. Dans l’action clandestine comme dans la lutte ouverte le Français reste trop individualiste. Pierre Brossolette estime que cette attitude, déjà fâcheuse dans la vie courante, est inexcusable dans la lutte contre la tyrannie étrangère. Des Français qui ont la volonté de vaincre et de redevenir libres doivent s’unir pour que leur action soit efficace. La tâche à réaliser n’apparaît-elle pas de plus en plus énorme et pour beaucoup inaccessible ? Au printemps les Nazis occupent la presque totalité des Balkans puis en été leur machine de guerre s’ébranle contre l’U.R.S.S. Les Panzer-Divisions s’avancent jusqu’aux portes de Moscou et de Léningrad…
Pierre Brossolette est de ceux qui ne se découragent pas. Comme le général de Gaulle, il pense que gagner des batailles n’est pas gagner la guerre. Les Forces de la Liberté n’ont pas dit leur dernier mot. Avec l’hiver 1941-1942, voici précisément que les États-Unis entrent en guerre et apportent aux alliés leur énorme potentiel industriel et humain. Le travail interne qui s’accomplit en France s’intensifie : un jeu de liaisons couvre maintenant Paris, couvre toute la France occupée et non occupée. Pierre Brossolette entre en contact avec les services secrets français par un des premiers réseaux de renseignements (C.N.D.) organisés en France, celui de Rémy. Ce dernier a raconté leur première entrevue, chez un autre Résistant du nom de Paco dans la clandestinité :
» L’homme me séduit dès l’abord, par son intelligence très vive et une sorte de flamme intérieure qui l’anime. Je lui demande de prendre en mains la rédaction d’une revue de presse que nous adjoindrions à nos courriers ; il accepte. Jim m’avait mis en relations avec un ménage de ses amis : M. et Mme Renaud de Saint-Georges. Lui dirige un garage : il sera pour nous Jasmin ; elle que nous appellerons Annette, a commencé déjà depuis plus d’un mois de découper dans la presse les articles les plus significatifs. Elle portera son travail à Brossolette qui en tirera une synthèse politique. Brossolette a quelque chose d’espagnol dans le visage : il aura nom Pedro. «
Par la suite Rémy rencontrera à la petite librairie de la rue de la Pompe, chez Pedro, Christian Pineau, chef du mouvement Libération-zone nord et son adjoint Vallon ; puis Langlois, un des chefs de l’O.C.M. (Organisation civile et Militaire) ; Lapierre, ancien secrétaire général du Syndicat national des Instituteurs, etc. Pendant toute cette période les rapports de Pierre Brossolette sont transmis aux services d’Information de Londres, rapports » aux conclusions étonnantes et qui toutes ont été vérifiées par l’événement « . Il prépare aussi des études sur les milieux politiques, littéraires, artistiques, sur l’état de la Résistance dans la France métropolitaine…
Un de ses rapports adressés outre-Manche a attiré sur lui l’attention du général de Gaulle lui-même. Pierre est invité à se rendre à Londres. Il accepte d’emblée, heureux de l’occasion qui lui est ainsi offerte de resserrer les contacts avec les organisations françaises de Grande-Bretagne. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’un départ » définitif « . Brossolette ne compte nullement s’installer dans quelque office sur les bords de la Tamise.
» Je ne veux pas être un rond-de-cuir de la Résistance « , confie-t-il à une amie. Dans les circonstances tragiques que traverse sa patrie, Pierre Brossolette estime qu’il faut beaucoup moins écrire qu’agir. Il a soif d’action et entend se jeter de toutes ses forces dans la mêlée. A ses proches, qui pensent ne le revoir qu’à la victoire, il déclare : » Mais vous allez me revoir bientôt. Je compte revenir dans quelques semaines, car ce que je veux éviter à tout prix c’est d’acquérir la mentalité de l’émigré. J’entends au contraire, quelle que soit la durée de la guerre, aller et venir entre Londres et Paris afin de garder le contact avec vous tous, avec la France, avec le peuple de France, lui tâter le pouls, savoir à tout moment où il en est, où en est sa volonté d’indépendance et de liberté… «
Et comme on lui objecte les dangers que ces allées et venues vont lui faire courir, il s’écrie : » Qu’importe ! On fait la guerre ou on ne la
fait pas! Moi qui ai jadis tant travaillé au maintien de la paix, j’ai fait la guerre en 1939-1940 et j’entends la continuer jusqu’à la victoire « .
Pierre Brossolette est en effet de ceux à qui pensait Jean Guéhenno quand il écrivait dans le Figaro, en décembre 1944 : » La guerre, remarquait Novicow, opère une sélection par en haut. Mais assez étrangement : la servitude aussi, et plus rigoureuse encore. Depuis quatre années, la servitude n’a pas cessé en France de trier les âmes. Un vieillard ambitieux n’a pas craint de se faire une sorte de royaume d’esclaves. ( » J’ai plus de pouvoir que Louis XIV « , disait-il). Il déclamait : » Il faut tenter de cesser le combat… Le peuple français ne conteste pas ses échecs… Il faut supporter l’inévitable. Le premier devoir est d’obéir… » Et tout ce qui est veule s’est rué dans la servitude, avec l’imbécile espérance d’assister en spectateur à des batailles qui intéressaient tous les hommes. Les âmes libres seules furent comme réveillées par l’outrage, et la guerre continua en dépit de tout ; mais elle ne fut plus faite, elle n’est plus faite aujourd’hui encore que par des volontaires…
» Et quels volontaires ? Volontaires contre l’opinion, contre l’ordre, contre la loi. Volontaires, en un sens plus élevé que ne le furent les volontaires mêmes de 1792, car ceux-là du moins étaient soulevés par l’élan de tout un peuple. Mais ces volontaires des années 1940 n’ont pu l’être qu’en se cachant. Chacun n’a trouvé qu’au fond de lui-même et dans son seul honneur, la force nécessaire à son engagement. Il est parti seul pour le maquis du Vercors ou d’Auvergne, pour l’Angleterre ou pour l’Algérie, comme on fuit, comme un suspect. Rien qu’une idée au fond de lui pour le soutenir « .
C’est ainsi que, volontaire par lucidité, par foi, par passion, dirons-nous même, Pierre Brossolette est parti pour Londres en avril 1942. 11 devait y faire, au total, trois voyages, séparés par de longs séjours en France.
Voyage secret à Londres
Le 26 avril 1942, donc, à Saint-Saens, en Haute-Normandie, il s’embarque à bord d’un Lysander de la Royal Air Force – le deuxième qui touche le sol français -, par une belle nuit de lune. » Si j’écris jamais mes mémoires, disait-il plus tard en riant à un ami, je les intitulerai : Gens de la Lune « . L’avion est en retard, les Allemands alertés : il faut faire très vite car le champ d’atterrissage est en pleine clarté lunaire. À peine Pierre est-il hissé dans la carlingue que la trappe se referme, le blessant légèrement à la tête. Peu importe : une heure plus tard, le voici dans la capitale de la libre Angleterre.
Rémy dans ses Mémoires dit avoir composé avant le départ la phrase qui de Londres devait annoncer l’arrivée de l’avion. « Elle comportait une approximation du pseudo de Pedro et du prénom de Jacques, celui de Denis (un autre agent de la Résistance parti par le même avion que Pierre). Elle est ridicule, mais il est impossible de ne pas la remarquer. C’est : la pétrolette a vidé son jacquet « . Le lendemain soir 27 avril, les initiés, – dont nous étions, – entendaient à l’émission de la B.B.C. l’étrange message.
Le voyage de Pierre étant clandestin, il ne peut voir à Londres que le Chef du Service secret, son adjoint et le Général de Gaulle.
L’intellectuel socialiste qu’est Pierre Brossolette n’aborde pas sans quelque prévention le militaire qu’est Charles de Gaulle. L’un et l’autre d’ailleurs ont une forte personnalité, mais l’un et l’autre aussi ont le même amour passionné de leur pays, le même sentiment de l’honneur et de la fierté nationale. Et puis Pierre Brossolette a lu les ouvrages publiés par le général avant le conflit et non seulement Vers l’armée de métier, dans lequel celui-ci expose sa conception de la guerre moderne, conception que les Allemands ont su si bien exploiter alors que notre Conseil supérieur de la Guerre, présidé par le maréchal Pétain, n’avait pour elle que mépris, mais aussi Le Fil de l’Épée, qui renferme des pages si fortement pensées sur la psychologie du chef et sur l’homme de caractère. Enfin le Général de Gaulle n’est-il pas le premier Résistant de France ? Cela suffit pour mettre en confiance Pierre Brossolette. Pendant son séjour donc les deux hommes ont de fréquents entretiens : ils ne sont pas toujours d’accord, certes ! mais c’est toujours le même souci qui les guide : arriver à une organisation plus efficace de la Résistance métropolitaine. Brossolette qui avant de quitter le continent a fait, pour être mieux renseigné encore, un voyage en zone non occupée brosse à son interlocuteur un tableau de la politique française aussi fidèle que son information multiple et son sens aigu des réalités le lui permettent. Il dit ce qu’était hier la vie des partis, ce qu’elle est devenue sous la botte nazie ; il explique ce que sont et ce que seront toujours les aspirations de la masse, sa soif d’une plus équitable répartition des richesses, son désir de justice sociale ; il expose en quoi consiste cette volonté de renouvellement qu’il a rencontrée chez beaucoup de bons esprits venus de tous les côtés de l’horizon politique : tout cela cœxistant avec un amour ardent de la patrie humiliée, une haine implacable pour les artisans et les exploiteurs de la défaite, un invincible espoir en de prochaines revanches et dans le triomphe final prophétisé dès juin 1940 par la France libre personnifiée par le Général de Gaulle.
Ce dernier écoute, demande des précisions, des explications, présente des objections, discute, cherche à se faire une opinion, à s’éclairer autant qu’il est au pouvoir de son interlocuteur de le lui permettre par l’étendue de son expérience et de son information ainsi que par l’absence de tout parti pris et de tout préjugé. Le général se trouve en présence d’un intellectuel devenu socialiste militant en raison de son attachement aux classes laborieuses, de sa foi dans le progrès social, d’un spécialiste des affaires d’Europe, qui, un des premiers, a dévoilé les ambitions hitlériennes et tenté par la plume et par la parole d’ouvrir les yeux des Français, d’un patriote qui entend lutter par tous les moyens et au besoin jusqu’au sacrifice suprême pour la restauration de la Patrie et de la République. L’intellectuel a en face de lui un technicien militaire moderne qui est un précurseur et dont l’excellence des conceptions a été hélas ! vérifiée par les faits ; un homme qui n’a jamais fait de politique mais qui ne semble avoir dans ce domaine aucune idée préconçue, qui désire se renseigner, se documenter, comprendre : un esprit compréhensif, épris d’équité, soucieux de justice ; un Français ardemment patriote qui, malgré l’éclipse momentanée de son pays, a foi dans sa destinée et dans sa grandeur. Les deux hommes ne peuvent pas ne pas se comprendre.
C’est le moment où le Général de Gaulle songe à élargir pour la fortifier la mission des Français de Londres en créant un Commissariat civil dans lequel il voudrait faire entrer des représentants des divers partis politiques de la France métropolitaine. Pierre Brossolette qui, nous l’avons vu, s’était préoccupé, dès son retour à Paris, après sa démobilisation, d’organiser un grand mouvement concerté, ne pouvait qu’entrer dans ces vues. Il décide donc de repartir pour la France afin d’y entreprendre une vaste consultation en vue de compléter le Comité de Londres.
Le moment semble mal choisi. Pierre Laval, en mai, est revenu au pouvoir. La collaboration s’accentue et la répression des menées gaullistes. On a perquisitionné dans la maison de Pierre ; son fils Claude, un enfant de quatorze ans, a été arrêté. Il subit six interrogatoires, rue des Saussaies ; au cours de l’un d’eux la Gestapo le laisse six heures debout, à jeun, devant un mur blanc pour le questionner ensuite, ébloui et recru de fatigue. Il réussit cependant à donner le change sur l’absence de son père : la Gestapo n’a pas appris que Brossolette était à Londres. Le cran et la ténacité de sa mère arrachent Claude aux Allemands, qui voulaient l’envoyer dans un camp de concentration.
Mais le réseau a été très éprouvé par une cascade d’arrestations. Son chef fait parvenir à Pierre un message l’avisant que son retour est impossible. Qu’importe ! Pierre veut partir malgré l’opposition des services qui jugent le voyage trop dangereux. Il obtient des Anglais, puisqu’il semble qu’un avion ne puisse atterrir sans danger, de prendre passage à bord d’un appareil quadrimoteur qui le parachutera » quelque part » en France, ceci malgré le chef de service responsable qui ne se résigne pas à laisser partir sans entraînement préalable un passager destiné à être parachuté. Et l’on sait que cet entraînement exige de l’endurance, du cran et même une certaine habileté technique pour arriver à sauter de diverses hauteurs, à maintenir l’équilibre en étant suspendu, à se recevoir en touchant le sol…
Première mission dans la clandestinité française
Le 7 juin 1942, en pleine nuit de lune, le Lancaster monté par un équipage tchèque traverse le nord de la France. Le terrain d’atterrissage, en Bourgogne, entre la Saône et la voie ferrée, est à peine repéré que Pierre Brossolette qui donc ne s’est jamais entraîné à ce genre de sport, sans la moindre hésitation, se laisse tomber dans le vide au signal du » dispatcher « . Il touche le sol un peu rudement : ce qui lui vaut quelques contusions. Mais, au total, il est sauf, passe le jour même clandestinement la ligne de démarcation et arrive le lendemain à Paris.
Son domicile est surveillé, il le sait ; aussi loge-t-il chez des parents ou des amis, changeant fréquemment de refuge afin de diminuer les risques courus. Au surplus, la surveillance dont il est l’objet est encore assez lâche, et pour circuler en plein jour dans les rues de la capitale, il se contente de porter un chapeau, – ce qu’il ne faisait jamais – et des lunettes noires.
Pierre Brossolette qui a quitté le réseau de Rémy, spécialisé dans le seul renseignement, déploie alors une activité politique considérable. Il prend de multiples contacts avec des personnalités appartenant aux milieux les plus divers : clergé, Front National, Parti Communiste, préfets, ainsi qu’avec les représentants des diverses organisations de Résistance de la zone nord et de la zone sud. Tous les éléments de la France enchaînée que Vichy n’a pas réussi à pervertir, il entend les rapprocher non en un parti mais en un Rassemblement ayant comme unique objectif la libération de la Patrie. Ses démarches lui valurent, – il nous le confia – quelques déceptions, mais surtout beaucoup d’encouragements et de satisfactions.
De Paris, il rayonne dans toute la grande banlieue à la recherche de terrains d’atterrissage, il se rend même en zone non occupée, passant et repassant jusqu’à 14 fois la même semaine, la ligne de démarcation. Durant des nuits entières, il déchiffre des messages de radio et en compose pour transmission à Londres, malgré la vigilance des occupants.
Il assure le départ en Grande-Bretagne d’André Philip, de Massigli, prépare celui de Charles Vallin ; organise aussi celui de sa propre famille qui après les deux perquisitions du mois de mai ne se sent plus en sûreté. Mme Brossolette liquide la librairie de la rue de la Pompe et d’une calanque de la côte provençale gagne avec ses deux enfants une nuit de juillet, le port de Gibraltar, sous le nom de Mme Passeur. De là un long voyage par mer les conduira à Londres, où Mme Brossolette allait, jusqu’à la Libération participer à la préparation des émissions françaises de la B.B.C.
Son mari poursuit ses contacts, puis franchit une dernière fois, avec un de ses neveux, la ligne de démarcation au nez des Allemands dans un tombereau à double fond, chargé de fumier, quelque part en Dordogne. Après un séjour dans la région de Toulouse et plusieurs vaines tentatives de départ par voie aérienne, il s’embarque à son tour pour Gibraltar, sur la côte languedocienne dans la région de Narbonne, à bord d’une felouque conduite par un patron polonais, au début de septembre 1942 ; embarquement mouvementé d’ailleurs : le canot qui fait la navette entre la plage et la felouque réussit sans encombre son premier voyage ; mais les Allemands alertés arrivent en force, tirent sur la deuxième » fournée » et en arrêtent tous les partants dont Christian Pineau et Jean Cavaillès qui furent emprisonnés à Montpellier, puis emmenés dans un camp de concentration d’où ils réussirent à s’évader quelques mois plus tard.
Le Messager de la France nouvelle
En septembre l’émission de la France libre, de la B.B.C. annonce l’arrivée à Londres du militant socialiste Pierre Brossolette et du député P.S.F. Charles Vallin dont elle souligne l’importante signification symbolique.
Le lendemain 22 septembre 1942 au soir, les millions de Français de la métropole et de l’empire à l’écoute de l’émission londonienne de la France libre pouvaient entendre :
» Pendant deux ans, Pierre Brossolette a mené la lutte sur le front intérieur de la France combattante.
» Pierre Brossolette est à Londres. Pierre Brossolette vous parle… «
Et c’est une voix fortement timbrée et prenante, où l’on sentait toutefois une émotion bien compréhensible, qui déclara à ses compatriotes :
Français,
Ce n’est pas sans débat que j’ai accepté de payer mon tribut d’arrivant en parlant aujourd’hui à ce micro. Car je n’ai pas oublié que dans le grand trouble des esprits et des cœurs de l’avant-guerre, la voix de Pierre Brossolette a suscité des inimitiés tenaces aussi bien que des fidélités passionnées. Et si j’avais pensé un instant qu’elle puisse maintenant encore réveiller la moindre division parmi les Français qui souffrent et qui luttent, je me serais tu avec sérénité : je n’ai pas la nostalgie du micro.
Mais il m’a finalement semblé qu’aujourd’hui, trop de mains se sont tendues entre les Français qui se combattaient hier, il m’a semblé qu’à travers les épreuves douloureuses et héroïques de la résistance, une trop profonde et trop magnifique complicité s’est forgée entre tous les Français pour que tous n’accueillent pas avec sympathie ce soir une parole qui n’est plus que celle d’un soldat de la seconde bataille de France parlant à ses camarades de combat. Et peut-être au contraire pour les mots de communion nationale que j’ai à prononcer sera-ce un poids supplémentaire que d’être dits par un homme qui passa naguère pour un partisan si violent.
J’aurais voulu dès ce soir fixer devant vous, devant ceux qui ont été et sont toujours nos amis, devant ceux qui ne l’ont pas été naguère et qui le seront demain, la leçon de notre arrivée commune ici, à Charles Vallin et à moi, la leçon de cette arrivée que nous avons, l’un et l’autre voulue commune pour montrer physiquement à tous qu’il n’y a plus entre les Français de fossé sinon le fossé séparant à jamais ceux qui veulent leur pays intact et libre et ceux qui le tolèreraient mutilé et asservi…
Mais aujourd’hui, je veux d’abord, parce que je crois que je le puis, je veux d’abord répondre à une des interrogations muettes mais ardentes de millions de Français et de Françaises.
Ces Français, ces Françaises, ils savent bien, certes, que ce n’est pas pour un homme que nous nous battons, mais pour une cause, que ce n’est pas un homme qui nous a rejetés dans la bataille, mais un geste, un sursaut – son geste, son sursaut – et que peu importe en principe le nom dont est signé le texte historique qu’aujourd’hui encore je ne puis relire sans que l’émotion me saisisse à la gorge, le texte que vous devriez tous savoir par cœur, le texte qui, à la fin tragique de juin 1940 nous a tous rappelés de l’abîme en nous disant : » La France a perdu une bataille mais la France n’a pas perdu la guerre… Il faut que la France soit présente à la victoire. Alors elle retrouvera sa liberté et sa grandeur… « . Ils savent tout cela qui précisément donne à notre bataille son sens et sa splendeur. Mais je n’en connais pourtant pas beaucoup qui, malgré tout, ne se demandent avec une sorte de curiosité passionnée, comment est l’homme en qui s’incarne depuis deux ans leur suprême espérance. Eh bien ! La réponse à cette question muette, la réponse que n’ont pu vous donner ni ceux qui sont arrivés ici sans connaître le Général de Gaulle, ni ceux qui ne sont pas libres de parler de lui, parce qu’ils sont ses collaborateurs directs, peut-être puis-je essayer de vous la fournir, moi qui le connais déjà, mais qui peux m’exprimer sur lui avec la liberté d’un homme parlant d’un autre homme.
Et alors, moi qui depuis 15 ans commence à avoir suffisamment vu de choses et de gens pour savoir où est le calcul et où le désintéressement, où est la fourberie et où la probité, où sont les idées courtes et où les grandes vues d’avenir, je vous dis à tous, à vous tous qu’a soulevés d’un même souffle le geste du 18 juin 1940 : » Français, ne craignez rien, l’homme est à la mesure du geste, et ce n’est pas lui qui vous décevra lorsqu’à la tête des chars de l’armée de la délivrance, au jour poignant de la victoire, il sera porté tout au long des Champs-Élysées, dans le murmure étouffé des longs sanglots de joie des femmes, par la rafale sans fin de vos acclamations. «
Voilà ce que je voulais d’abord vous dire ce soir. Mais voici maintenant ce qu’il faut que je vous demande. A côté de vous, parmi vous, sans que vous le sachiez toujours, luttent et meurent des hommes – mes frères d’armes, – les hommes du combat souterrain pour la libération. Ces hommes je voudrais que nous les saluions ce soir ensemble. Tués, blessés, fusillés, arrêtés, torturés, chassés toujours de leur foyer, coupés souvent de leur famille, combattants d’autant plus émouvants qu’ils n’ont point d’uniformes ni d’étendards, régiment sans drapeau dont les sacrifices et les batailles ne s’inscriront point en lettres d’or dans le frémissement de la soie mais seulement dans la mémoire fraternelle et déchirée de ceux qui survivront : saluez-les. La gloire est comme ces navires où l’on ne meurt pas seulement à ciel ouvert mais aussi dans l’obscurité pathétique des cales. C’est ainsi que luttent et que meurent les hommes du combat souterrain de la France.
Saluez-les, Français ! Ce sont les soutiers de la gloire ! «
S’adressant aux lecteurs de son journal Les Nouvelles, Jean Marin, de l’équipe de la B.B.C. de Londres, a rapporté, en mars 1945, le souvenir symbolique que lui a laissé cette arrivée de Pierre Brossolette à Londres :
» Il était de ceux dont nous avions de loin le plus suivi la lutte clandestine, si audacieuse et si féconde. En parlant avec lui, en l’écoutant faire ses récits avec autant de modestie que d’humour, nous nous disions : » Voilà donc un de ces Français, nos compatriotes, qui, avec tant de courage, luttent pied à pied contre l’emprise allemande, contre la honte, contre le désespoir « . Pierre Brossolette était à nos yeux l’un de vos messagers, l’un de vos représentants. A travers lui, nous jugions nos compatriotes. Jamais nous n’oublierons la fraternelle gratitude que nous lui avons vouée, pour nous avoir apporté une image aussi belle, aussi pure, aussi exaltante du pays loin duquel les conditions de notre lutte nous retenaient. Lorsque nous vous parlions, lorsque nous vous disions de conserver à tout prix l’espérance, c’étaient ses propos et les propos de ses semblables, son action et l’action de ses compagnons qui nous inspiraient et qui donnaient à nos paroles leur plus claire justification. «
Quant à son camarade d’équipe Maurice Schumann, voici ce que furent ses impressions, telles qu’il les a évoquées à la Sorbonne dans la manifestation commémorative du 22 mars 1945 : » En cette fin d’avril 1942, rares étaient les émissaires de la France militante et souffrante à la France libre et combattante, plus rares encore les privilégiés admis à leur serrer la main, à reprendre force en touchant leur vaillance. Quand on m’a dit que M. Bourgat m’attendait, je ne pensais point que M. Bourgat pût être un cacique de l’École Normale Supérieure et de l’agrégation d’histoire, un journaliste connu de tout Paris. un chroniqueur radiophonique dont le nom même avait suscité – je le savais – des inimitiés tenaces et des amitiés passionnées. Je savais que Pierre Brossolette plutôt que de prostituer sa plume ou de chercher un accommodement quelconque avec le malheur de la France, ou même de considérer d’un œil triste et passif le crépuscule de l’intelligence et de la liberté, avait, pour nourrir les siens, ouvert devant son vieux Lycée, une boutique de libraire. Je trouvais cela très bien, je ne pensais point qu’un homme aussi notoire pût risquer beaucoup plus : je ne connaissais pas Brossolette, du moins tel qu’il était.
Je ne savais pas que l’épreuve de 1940, en asservissant la Patrie, avait libéré tout ensemble ce qu’il y avait de pire chez les mauvais et de meilleur chez les bons. Après avoir pendant cinq minutes écouté M. Bourgat, il me paraissait impossible de trop attendre de la France, il car il ne disait jamais » je « , il disait toujours » nous « , avec une sécheresse froide qui me donna d’emblée la certitude que » nous » voulait dire des millions. Son intelligence ordonna à mon enthousiasme, non pour le tempérer, mais, au contraire, pour l’exalter. Avant lui, je croyais à la flamme de la Résistance ; après lui, je crus à sa force ; avant lui, je croyais à la France fervente et fidèle, après lui, je crus à la France puissante dans son refus organisé, dans sa colère articulée, dans sa douleur… «
A Londres, cette fois Pierre Brossolette est libre de ses mouvements. Il est prudent par suite qu’il change d’état civil. Le voici maintenant dénommé Bourgat et c’est sous ce nom de guerre qu’il contracte son engagement officiel dans les Forces Françaises libres où il était engagé secrètement depuis 1941.
A peine arrivé il déploie au grand jour son activité politique. Les multiples contacts qu’il a eus pendant son séjour en France avec les représentants les plus qualifiés de l’opinion française, avec la masse aussi, avec le peuple des deux zones, celui de la capitale et celui de la province, lui permettent de proclamer avec une autorité accrue, ce qu’il a envisagé dès le lendemain de la défaite : la nécessité du rassemblement unique. Dès le 27 septembre, il publie, dans le journal français La Marseillaise de Londres, un article intitulé Renouveau politique en France.
« Ce qui frappe extraordinairement quand on arrive à Londres, en venant de France, écrivait-il, c’est l’erreur énorme qui se commet généralement ici sur les dispositions politiques de la France. Visiblement, une grande partie du public anglais et américain – de même qu’un certain nombre de Français établis en Angleterre ou aux États-Unis depuis deux ans – croient que les Français se traitent encore mutuellement de fascistes ou de bolchevistes, de réactionnaires honteux ou de cartellistes impénitents. Dès qu’on est depuis deux jours ici, on se sent catalogué comme autrefois selon les vieilles déterminations politiques. Avec les meilleures intentions du monde, on semble même épouser à notre place nos anciennes querelles politiques et prononcer de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite des exclusives auxquelles aucun de nous ne songerait plus un seul instant.
Il est dommage que ceux qui commettent ce genre d’erreur sur la France ne puissent en ce moment aller faire un tour dans notre pays. Ils y constateraient que toutes les divisions politiques du passé y sont bien oubliées et qu’il y a une bonne chance qu’elles y soient oubliées pour longtemps. Tous les Français qui arrivent ici s’épuisent à expliquer qu’actuellement chez nous, il n’y a plus d’opposition, disons même le mot, qu’il n’y a plus de haine de parti politique à parti politique, mais seulement entre résistants et collaborationnistes, en d’autres termes, entre gaullistes et traîtres. Et superficiellement, on semble bien croire ce qu’ils disent ainsi. Mais profondément, on ne paraît pas encore avoir ressenti ici toute l’ampleur et toute la portée de cette transformation.
Elle était pourtant esquissée déjà dès la veille de la guerre. Dès cette époque, le classement en » munichois » et » antimunichois » tendait à briser le cadre des anciens partis. Léon Blum se sentait, sur des questions essentielles, bien plus proche de Paul Reynaud que de Paul Faure et Georges Bonnet avait plus de points communs avec Carbuccia qu’avec Herriot. La défaite, l’occupation, l’abaissement du pays par le gouvernement de Vichy, la résistance ont donné à ce redressement une sorte de réalité physique qui le rend désormais ineffaçable. Elles lui ont donné aussi une forme tout à fait nouvelle.
Qu’on le veuille ou non, la politique se fonde, en réalité, dans tous les pays du monde, sur des affinités et sur des répugnances bien plus que sur des idées. Hier, en France, c’était selon leurs affinités que les Français se groupaient dans les partis politiques et selon leurs répugnances qu’ils s’opposaient de parti à parti. Aujourd’hui, c’est sur un autre plan que jouent les sympathies et les haines, les amitiés et les mépris ; quelles que soient leurs anciennes tendances, les collaborationnistes se sentent unis par une sorte de complicité honteuse et par une haine inexpiable de ceux qui les désavouent et les combattent, de même que l’immense masse de ceux qui résistent se sent intimement soudée par une fièvre commune et par un mépris invincible pour tous les traîtres, les demi traîtres et les quarts de traîtres.
Ce phénomène éclatant, brutal, semble sans doute avoir été perçu à Londres et à Washington. Mais il ne paraît pas que certaines de ses conséquences capitales, que certains de ses aspects essentiels soient encore bien clairement compris.
En particulier, on n’arrive pas à considérer l’énorme parti de la résistance comme un bloc et à lui donner son véritable nom – celui qu’il se donne à lui-même, celui que les Allemands et les gens de Vichy lui donnent – celui de gaulliste. Je découvre avec stupeur ici une foule de gens qui ont l’air de croire qu’en France il peut y avoir des résistants qui ne soient point gaullistes. J’y ai découvert aussi avec plus de stupeur encore, qu’il paraît qu’on pourrait être résistant sans être gaulliste. Pour l’opinion française, pour cette opinion tout entière, une telle attitude serait incompréhensible. En France on est gaulliste ou anti-gaulliste. Et on ne peut pas être autre chose. Léon Blum – je ne crains sur ce point aucun démenti – Léon Blum est gaulliste, André Philip, Gouin, moi-même, sommes gaullistes depuis les premiers jours. Paul Reynaud est gaulliste. Louis Marin est gaulliste. Dès que Charles Vallin a cessé de croire en Pétain, il a été gaulliste. Entre les deux attitudes, il n’y a pas de tiers parti possible.
À lui seul, le problème de la résistance aurait donc déjà suffi à dévaluer absolument les anciennes divisions politiques françaises. Mais un autre phénomène y contribue également avec force. C’est la volonté générale de rajeunissement et de changement qui rapproche aujourd’hui des esprits hier très opposés. Là encore, je ne crois pas que l’évolution française ait encore été bien perçue ici. Parce que la plupart d’entre nous, par fidélité à des chefs malheureux ou à des partis frappés d’interdiction, ont voulu conserver leurs anciennes qualifications politiques, parce qu’ils ont mis parfois une certaine coquetterie à le faire, on n’a pas compris ici qu’en réalité ils ont profondément changé. André Philip, moi-même, tous nos amis de France, nous n’avons pas renié le socialisme ; mais notre socialisme est entièrement renouvelé par le bouleversement du monde depuis trois ans ; et là encore, je ne crains aucun démenti en disant que le cas de Léon Blum est le même. Du côté d’un parti comme le P. S. F., l’évolution est peut-être moins nette ; elle a peut-être été un peu brouillée par le jeu de Vichy ; mais elle n’est pas moins certaine. J’ai assez parlé avec Charles Vallin depuis deux ans pour savoir que s’il est resté dans le cadre de son parti, c’est avec des idées et des dispositions entièrement renouvelées ; il en est de même pour les milliers de P. S. F. qui le considèrent comme leur chef véritable et qui vont le manifester en rompant à sa suite avec Vichy ; il en était de même déjà de ceux des adhérents du P. S. F. qui se sont mis en marge de l’organisation par » gaullisme » et qui vont se retrouver à ses côtés maintenant qu’il est publiquement libéré. Dans, tout ce qui peut matériellement subsister des anciens partis politiques, on trouverait de même cette volonté de renouvellement profond de la vie politique française. (Je laisse ici de côté, parce qu’il mériterait à lui seul une étude, le problème du parti communiste français). Nécessité d’un exécutif stable et fort, nécessité d’une planification de l’économie, nécessité du » contrôle » de tout le secteur concentré de l’industrie, volonté bien arrêtée de ne pas revoir le gâchis d’autrefois, nécessité pour remettre le pays sur pied d’une collaboration étroite et amicale de ce qu’il y avait de meilleur à gauche et de meilleur à droite ; sur tous ces points, sur bien d’autres encore, les esprits venus de toutes les directions politiques témoignent aujourd’hui d’une volonté commune de renouvellement. Les anciens dirigeants des partis se l’avouent peut-être avec moins de facilité que les plus jeunes. Mais chez ceux-ci, l’évolution est caractéristique. Et ce n’est pas absolument un hasard si André Philip, moi-même, Charles Vallin, Louis Vallon, qui sommes ici, aussi bien que des camarades restés en France, sentons étroitement entre nous la solidarité de nos quarante ans.
Fusion de tous les éléments résistants des partis politiques dans un » gaullisme » de plus en plus général, accord profond pour le renouvellement radical de la vie politique française, les deux phénomènes ne sont point indépendants l’un de l’autre. Les chefs de la résistance et ceux que j’appellerai, pour me moquer de l’histoire, les chefs du mouvement étant les mêmes, il se trouve tout naturellement que c’est dans le cadre de la résistance, dans le cadre du » gaullisme « , que la France compte opérer, au lendemain de la libération, sa transformation politique. À cet égard comme pour la libération du territoire, au point de vue politique, par conséquent, comme au point de vue militaire, la France combattante a d’ores et déjà la confiance de l’immense majorité du pays, qu’elle représente beaucoup mieux que ne l’ont jamais représenté les gouvernements d’avant la guerre et la défaite.
Est-ce à dire qu’il n’y aura pas quelques épines à enlever sur le chemin qui mène par la libération du territoire à la reconstruction de la France ? Il serait puéril de le croire. Des intérêts, grands et petits, se jetteront à la traverse. Les grands trusts qui ne veulent point être soumis au contrôle d’un pouvoir fort et qui sont les véritables champions d’une lutte de classes, d’une division politique dont ils entendent profiter, s’opposeront par tous les moyens à la naissance de la France nouvelle. Tous les vieux renards de la politique, aujourd’hui terrés dans leurs trous, embusqués derrière le paquet d’actions de leur petit journal local qu’ils ont mis à la disposition des Allemands et de Vichy, sous prétexte de ménager l’avenir, tous ces vieux comitards essaieront de nous ramener à la France comitarde d’hier dont la résurrection seule permettrait leur retour au pouvoir. Et puis, il y a le poids du passé. Si dégagée de l’ornière que la masse des Français soit aujourd’hui, les vieux slogans des divers partis politiques leur ont été ressassés pendant trop d’années pour que quelques fanatiques attardés des luttes passées n’essaient pas de reconstituer les anciennes formations et de dresser les familles sociales les unes contre les autres, au nom des tactiques traditionnelles et antagonistes de » classe contre classe » et de » lutte contre le marxisme… «
Pierre terminait en exprimant le souhait » que les » espèces » de » familles » spirituelles ou sociales que représentaient tant bien que mal les anciens partis politiques aient, toutes, leur part légitime dans la reconstruction du pays « , en s’agrégeant au mouvement de la France combattante, en groupant autour du général de Gaulle, selon le vœu de la nation asservie, leurs éléments les plus dynamiques pour la rénovation du pays comme pour sa libération.
Un tel article établit avec force le point de vue de Pierre Brossolette dans la Résistance, point de vue qui était généralement celui des Résistants de la France occupée. Les évènements qui ont suivi la libération ont sans doute déçu quelque peu ces espoirs. Il ne semble pas que le Gouvernement d’Alger, arrivé sur le sol de France ait senti avec assez d’acuité toutes les possibilités qu’offrait alors ce grand parti de la Résistance. Le général de Gaulle lui-même n’a-t-il pas souhaité que ses membres, acceptant la dissociation de leur Mouvement, aillent seulement jouer dans les partis qui se reconstituaient le rôle d’animateurs ? Il n’en demeure pas moins que les consultations électorales postérieures ont prouvé que la France donnait sa confiance aux partis nouveaux ou renouvelés qui se réclamaient de la Résistance et de ce programme du Conseil National de la Résistance où s’inscrivaient leurs espoirs. Et la présence, malgré leurs divergences, des trois grands partis actuels dans le gouvernement, traduit ce désir tenace de la France sur lequel Pierre Brossolette mettait l’accent, de voir ses meilleurs éléments participer à son redressement.
Par ailleurs cet article de La Marseillaise avait alors un caractère actuel. Il s’agissait d’afficher une profession de foi, de déployer un drapeau, dans un milieu où des factions s’agitaient en ignorant la volonté d’unité de la France asservie, synonyme pour cette dernière de » Gaullisme « .
Il y avait en effet parmi les Français de Londres, des antigaullistes. » Tous les Français qui avaient passé la mer et étaient venus en Angleterre après l’armistice de Juin 1940, écrit l’un d’eux, Jean Oberlé, étaient sans exception, profondément et sincèrement opposés au gouvernement de Vichy et à l’infâme politique de collaboration. Mais parmi eux, il y eut, dès 1941, quelques Français qui, passionnément attachés à l’idée républicaine craignaient que le général de Gaulle ne devînt, par sa situation même et sa popularité qui ne cessait de croître en France, une sorte de général Boulanger, voire de Napoléon III ! Or le général de Gaulle ne cessait de rappeler dans ses messages et ses discours la validité de la IIIe République, et lorsque je demandais à mes amis de l’opposition ce qui leur faisait craindre un gaullisme boulangiste, ils me répliquaient que le général de Gaulle n’était plus un général, malgré son uniforme, mais un politicien et que d’ailleurs son entourage comportait des militaires, et même des civils, plus amis des trusts que du peuple. Car la plupart de ceux qui constituaient l’opposition étaient surtout des » hommes de gauche « . C’était le cas de Labarthe et des collaborateurs de France. «
Ce n’était pas, on l’a vu, le cas de Pierre Brossolette, homme de gauche pourtant lui aussi, homme d’extrême-gauche même, toujours fidèle à sa foi socialiste. D’une part, il avait confiance dans la parole et les promesses du général, d’autre part si son entourage n’était pas sans le décevoir quelque peu, il pensait que toute velléité de pousser le chef de la France combattante même malgré lui sur la voie du bonapartisme aurait vite fait d’être balayée au jour de la libération par le peuple de France.
Restaient toutefois l’attitude et les manières du général de Gaulle. » Un abord assez froid, parfois glacial, des manières distantes, le tout assez imposant, majestueux, mais point fait pour la sympathie immédiate « , écrit aussi Jean Oberlé qui ajoute : » Cela décevait beaucoup de ceux qui l’avaient rallié sincèrement et l’auraient suivi n’importe où. Cela irritait aussi. D’autant plus que le général s’exprime d’un ton hautain, coupant, parfois désagréable « .
Nous savons que Pierre Brossolette fut de ceux qui regrettèrent aussi cette attitude. Il déplorait que sur certains sujets le général de Gaulle ne tolérât pas de contradiction ; que son caractère impérieux ne supportât aucune critique et considérât même celles qui pouvaient lui être timidement adressées, comme provenant d’une sorte d’infirmité de la pensée ou du patriotisme. Cette attitude était de nature, croyait-il, soit à décourager les bonnes volontés prêtes pourtant à apporter au général un concours loyal et désintéressé, soit, ce qui risquait d’être plus grave, à faire qu’il ne rencontre plus autour de lui qu’une approbation systématique.
Mais par ailleurs Pierre estimait que l’union de tous les Français autour du » premier Résistant de France » était nécessaire au salut de notre pays, à sa reconstruction et à son avenir aussi. Il fallait pour cela faire abstraction du caractère altier et peu accommodant de » cette figure hautaine, peu réductible aux contingences et même aux circonstances « . Il le fallait au risque de passer près de certains pour une sorte de néo-fasciste.
Quelques socialistes français émigrés murmuraient cette accusation dans l’entourage de leur camarade, appuyés d’ailleurs par des travaillistes anglais qui allèrent jusqu’à demander au Parlement à M. Eden s’il était au courant des précédents » fascistes » de Charles Vallin avec qui Pierre était arrivé en Angleterre. Le Ministre des Affaires Étrangères se contenta de répondre que M. Vallin avait été introduit en Grande-Bretagne par M. Brossolette, » ancien chef de cabinet de M. Blum « .
À M. d’Ydewalle, journaliste belge qui lui rapportait cette répartie. Pierre Brossolette répondit : » C’est parfait. Il ne m’en faut pas plus, Je n’ai jamais été chef du cabinet de Blum. Je n’ai été que directeur de la politique extérieure du Populaire, parce que j’avais beaucoup d’admiration pour Blum. Mais ça ne fait rien. Vallin est un monsieur de droite qui fait la guerre. Moi, vieux Front Popu, je ne connais que ça : faire la guerre. Le père de Gaulle avait déjà compris ça le 18 Juin 1940 : faire la guerre. Voyez-vous il n’y a que cela qui compte en ce moment « . C’est parce que le général de Gaulle veut » faire » la guerre, au sens que Clemenceau avait donné à cette formule, que Pierre Brossolette entend l’aider de toutes ses forces, sans le moindre fétichisme et en toute indépendance.
Cependant à Londres comme à Washington certains milieux de l’émigration française persistent dans leur attitude anti-gaulliste. Pierre Brossolette s’en indigne et poursuit avec opiniâtreté sa campagne d’union autour du général. » Un seul combat pour une seule victoire ! « . Oublierait-on chez certains qu’il y va du sort de la France ? Soutenu par ses amis André Philip et Pierre Bloch, socialistes comme lui, mais comme lui partisans du rassemblement unique, il fait front à ceux qui l’accusent d’être fasciste et partisan d’une dictature militaire, à ceux qu’il craignait de voir un jour regagner Paris en émigrés. » J’ai toujours peur, confie-t-il à un de ses amis, que certains des nôtres reviennent après la victoire dans l’esprit de ce chambellan de la Cour de Sardaigne à Turin qui, en 1815, à 94 ans, réclamait et obtenait l’habit brodé et les clefs de sa charge abandonnés en 1789…
« .
Il entreprend, d’autre part une vaste propagande profrançaise dans les milieux londoniens et étrangers : tchèques, polonais, etc., fait des conférences en français et en anglais dans les clubs de la capitale, multiplie les contacts avec les partis politiques et la presse britanniques. A tous, il fait comprendre l’importance de la Résistance française, le rôle qu’elle peut et doit jouer dans les opérations qui ‘conduiront à la Libération du pays et le total ralliement de ses troupes autour du chef de la France combattante.
Le Général de Gaulle souhaiterait prendre Pierre Brossolette comme chef de son cabinet civil. Mais ce projet se heurte à une vive opposition, à gauche comme à droite et n’aboutit point. L’activité de Pierre n’en est point ralentie pour autant et son désintéressement reste entier : c’est à son pays qu’il entend consacrer toutes ses forces. Il donne alors, nous a déclaré une de ses amies, qui séjournait à Londres durant cette période, l’impression d’un homme qui dépassait nettement la plupart de ses contemporains, qui leur était parfois dur parce qu’avec son infatigable dynamisme, il avait un certain mépris pour les timorés, pour tous ceux qui n’étaient pas à la hauteur de leur tâche et que son ironie acérée ne ménageait ni les incapables, ni les hésitants, encore moins tous ceux qui avaient en vue plus leur intérêt que l’intérêt de la France. Mais cette ironie masquait en réalité une sensibilité frémissante et une extrême délicatesse. Jamais rien de petit chez lui ; de même qu’en temps de paix, il avait plus le souci du succès de son parti et de ses idées que du sien propre, de même maintenant, les satisfactions personnelles lui importaient moins que la réalisation de cette idée féconde de regroupement national autour du Général de Gaulle pour le salut et la résurrection de la patrie. Homme d’action certes, et qui mobilise toutes ses forces pour le combat, mais chez qui l’activité intellectuelle est toujours aussi intense.
» Malgré tout, écrit M. d’Ydewalle, chez cet homme d’action, l’esthète intellectuel perçait à chaque instant. Il avait son bureau alors dans Duke Street et son intelligence critique lui permettait, entre un appareil de téléphone et une machine à écrire, autant de fines digressions que si jamais il n’avait quitté l’École Normale, que si jamais il n’avait sauté en parachute… « .
Le 17 Octobre 1942, le général de Gaulle décerne la Croix de la Libération au Commandant Bourgat Pierre qui devient Compagnon de la Libération pour le motif suivant :
Modèle d’esprit de devoir et de sacrifice. Organisateur d’un rare mérite, a fait preuve au cours des très importantes et périlleuses missions qui lui furent confiées d’un. dévouement exemplaire au service de la France.
Et quelques jours plus tard, le 28 Octobre, Pierre Brossolette était nommé membre du Conseil de l’Ordre de la Libération.
Les événements d’Algérie
Bientôt les évènements se précipitent. Le 8 Novembre les troupes alliées débarquent en Afrique du Nord. Darlan, qui a eu vent des préparatifs de l’opération et est arrivé l’avant-veille sous prétexte de rendre visite à son fils malade, est arrêté par la Résistance. Délivré par un groupe d’officiers vichyssois, il traite maintenant d’égal à égal avec les Américains qui acceptent de le reconnaître comme représentant l’autorité française légitime en Algérie. Du même coup le général de Gaulle, chef de la France combattante n’est pas autorisé à se rendre en Afrique du Nord. On sait que trois jours plus tard, le 11 Novembre, le Führer ordonne à ses troupes d’occuper la partie de la France encore libre… et que le 27 Novembre la flotte française de Toulon se sabordait pour ne pas tomber aux mains des Allemands.
L’élimination du général de Gaulle au profit de Darlan, c’est-à-dire la consécration donnée à la trahison par les Alliés et plus particulièrement par le gouvernement américain, provoque en Grande Bretagne une vive émotion dans les milieux gaullistes ainsi d’ailleurs que dans certaines sphères anglaises. N’est-ce pas la Quaterly Review qui écrivait plus tard à propos de ce qu’elle qualifiait » la lamentable histoire Darlan » : » Si Darlan était favorisé comme chef de son pays, ni Hacha, ni Degrelle, ni Quisling lui-même, ne pouvaient être considérés comme des hommes de paille aux yeux des Américains. Notre but fondamental de guerre, de défense de la liberté et de la justice, avait été jeté par-dessus bord… « .
Pierre Brossolette, on le devine, ne pouvait pas ne pas se dresser vigoureusement contre l’imposteur. Dans la Marseillaise du 6 Décembre 1942, il consacre un de ses plus fougueux articles à l’affaire Darlan, article intitulé » Ce qu’ils en pensent « . » ils » désignant les Résistants de France occupée :
» CE QU’ILS EN PENSENT ?
» Ils » ce sont les obscurs, les sans gloire, ceux qui n’ont pas le moyen de s’exprimer et qui ne l’ont jamais eu depuis deux ans, parce que depuis deux ans ils vivent étouffés par l’occupation allemande ; ce sont ceux qui, dès juillet 1940, ont choisi, et qui, pour le trentième mois maintenant, continuent contre l’Allemagne leur lutte silencieuse, héroïque, efficace. Ceux dont on n’a pas beaucoup parlé ces temps-ci.
Nous avons entendu une référence aux réactions » de l’opinion publique aux États-Unis, en Grande-Bretagne et dans les Nations Unies « . La protestation des mouvements de résistance et des organisations politiques de l’ancienne zone libre a pu parvenir ici, et elle a été publiée – tout au moins publiée par la s Marseillaise « . Les marins de Toulon ont été célébrés comme ils le méritaient. On s’est préoccupé de feue l’Armée de l’Armistice. Des hypothèses – parfois surprenantes – ont été faites sur les sentiments de MM. Darlan, Noguès, Châtel et autres Boissons. Mais des vingt-cinq millions de Français de la zone occupée – de l’ancienne zone occupée du moins, – de ces vingt-cinq millions de Français qui sont rentrés dans le combat comme ceux de la France combattante, au lendemain même de l’armistice honteux, de ceux-là qui donc a parlé au cours de ces quatre dernières semaines ? Le monde les ignore-t-il ? Le monde est-il systématiquement décidé à les ignorer ? En proclamant que maintenant après Toulon, la France » reste dans la guerre « , qu’elle » ressuscite » enfin, a-t-on pris garde qu’on semblait dire à cette majorité de la France qui se bat depuis deux ans et dont les plus purs représentants ont connu la chasse à l’homme, la prison et le peloton d’exécution, a-t-on pris garde qu’on semblait leur dire que toutes ses blessures et tous ses sacrifices ne comptent point, qu’ils n’avaient pas suffi à ressusciter la France et que pour nous redonner une patrie, il a fallu que l’amiral de Laborde fît, sans mourir lui-même, couler les bateaux qu’il n’a jamais voulu relancer dans la lutte aux côtés des Alliés, qu’il n’a même jamais voulu mettre à l’abri de la menace trop certaine de l’Allemagne ?
Ces vingt-cinq millions de Français de la zone occupée, ils n’ont point de mouvements de résistance pour traduire leurs sentiments ; tous les groupes qu’ils ont constitués dès 1940, ont été, en six mois, décimés et pulvérisés par la Gestapo. Ils n’ont pas eu non plus de diplomatie étrangère pour envoyer à leur propos les rapports que tant d’ambassadeurs ou de consuls ont adressés à leurs gouvernements sur Vichy, en croyant que Vichy c’était la France. Ils n’ont même pas eu ici les porte-parole dont a bénéficié la zone libre, Philip, Gouin, Diethelin et tant d’autres qui ont essayé de faire comprendre au monde quels sont, sous l’écusson de Vichy, les véritables sentiments populaires de l’ancienne zone libre. De la zone occupée, on est beaucoup moins venu ici. En ce moment même, combien sommes-nous à Londres qui puissions en parler par longue expérience ? En dehors de Louis Vallon, d’André Duval, de Madeleine Le Verrier, de moi-même, de quelques autres encore que je m’excuse de ne pas connaître peut-être, elle n’a guère eu de délégués ici, cette vraie France, cette France de la première heure. Et pourtant, dans l’espèce de tragique et sordide » affaire Darlan s, qui donc devrait avoir son mot à dire sinon elle sans la résistance de qui M. Darlan, M. Laval et le Maréchal Pétain auraient peut-être signé la paix avec Hitler au lendemain de Montoire, au prix de l’Alsace-Lorraine et d’une partie de nos départements du Nord.
Cette France, que je quitte à peine, et dont je suis encore, pour y avoir vécu deux années attentives et passionnées, je veux dire ici sa stupeur et son bouleversement en voyant qu’aujourd’hui une grande initiative des Alliés avec lesquels elle se bat a eu pour dernière conséquence l’installation à Alger d’un Darlan malgré qui et contre qui elle s’est battue depuis trente mois. Il faut se rendre compte que l’isolement et la souffrance ont accru sa sensibilité. Elle réagit avec violence à la joie et au désespoir. Pendant des mois, elle a été suspendue à l’attente douloureuse des premiers signes de la contre-offensive et de la victoire. Et voici qu’au moment où enfin la triple nouvelle des victoires britanniques en Libye, des prouesses russes à Stalingrad, et des débarquements anglo-saxons en Afrique du Nord, troue d’un premier rayon de certitude son ciel de misère et d’agonie, il faut qu’aussitôt elle soit replongée dans le doute en voyant hisser sur le parvis l’homme qu’elle a justement considéré depuis deux ans comme l’un des plus misérables parmi les profiteurs de la défaite et parmi les valets du vainqueur. Dans l’écœurement dont elle nous a fait parvenir l’écho par les messages les plus explicites, il n’y a rien de bas. Le sursaut qui a secoué la France quand elle a vu l’Afrique du Nord livrée à Darlan, ce n’est pas un désir rentré de légitime vengeance qui l’a provoqué. Ce n’est même pas le sursaut des condamnés, des » détenus administratifs s, des déchus, des bannis, des traqués devant l’incroyable honneur fait à leur tortionnaire dans un pays libéré par les nations mêmes pour lesquelles ils ont été condamnés, détenus, déchu,. bannis, traqués. C’est le sursaut des Français qui sont restés Français, devant l’absolution donnée à un Français qui ne l’est pas resté ! Le sursaut de l’honneur devant l’exaltation de la bassesse. Le sursaut de la fidélité bafouée.
Mais c’est encore bien plus que cela ; et pour le comprendre, il faut peut-être avoir vécu longtemps dans la France défaite et occupée par les Allemands.
Le drame de la France, c’est que l’effondrement de juin l’avait amenée à douter de toutes les valeurs pour lesquelles elle avait vécu jusqu’alors. Chrétienne ou laïque, socialiste ou libérale, la France, comme l’Angleterre et les États-Unis, avait toujours gardé, jusqu’au jour du désastre, sa foi dans la personne humaine. son attendrissement pour le faible et son horreur de l’injustice. Et voici qu’au jour de la défaite, un Pétain, un Darlan, un Laval sont venus lui dire que si elle a été vaincue c’est justement parce que le respect de la personne humaine est une infirmité, parce que la sollicitude pour le faible est la pire des faiblesses et parce qu’il n’y a de force que dans l’injustice. Voilà ce qu’ils ont dit ; et en accablant de leurs sarcasmes les démocraties demeurées fidèles à l’idéalisme, ils ont voulu contraindre les Français à croire qu’il n’y avait de rédemption possible que dans un ralliement abject au totalitarisme, au réalisme, au cynisme, et dans une soumission honteuse à l’ennemi à qui ce totalitarisme, ce réalisme, ce cynisme semblaient alors avoir assuré la victoire.
La France allait-elle céder à l’affreuse tentation de renier ainsi deux mille ans de vie spirituelle et morale ? Allait-elle s’abolir dans un désaveu du patrimoine qui lui était commun avec les peuples anglo-saxons, dans une renonciation définitive à elle-même ?
C’est ici que se place la plus grande page de gloire commune à la France Combattante et à la France Résistante. À Londres, la voix du général de Gaulle a claironné aux Français qu’au contraire, c’est pour les valeurs spirituelles qu’il fallait continuer à se battre, et que c’est en se battant pour ces valeurs spirituelles qu’on arriverait un jour à la victoire. Et réveillé du tombeau par cet appel miraculeux, le peuple de France -le peuple de la France occupée le premier. puis peu à peu le peuple de la France libre a compris ; il a suivi, dans un immense frémissement muet, il s’est tout entier donné. Et pour de longues années, le sens de la lutte s’est fixé dans son esprit. C’est la lutte entre tout ce que représente un de Gaulle et tout ce que représentent un Laval, un Darlan, un Pétain ; la lutte entre toutes les valeurs occidentales, avec ce quelque chose de fier que leur a ajouté ce geste de défi du Général de Gaulle en juin 1940, et toutes les valeurs hitlériennes avec ce quelque chose de plus bas encore que leur a donné la prostitution vichyssoise. Entre les deux, il s’est prononcé. Une poignée d’écumeurs et de matraqueurs auxquels s’est ajoutée, dans la zone libre, une minorité chaque jour plus réduite de maniaques de l’obéissance passive, a seule choisi Hitler. En se proclamant gaulliste, tout le reste, la quasi-unanimité du peuple français a signifié qu’il entendait donner son sang, ses souffrances et ses larmes pour poursuivre la lutte et participer à la victoire sur Hitler et tous les agents d’Hitler, qu’ils se nomment Gœring ou Laval, Abetz ou Darlan.
Peut-être, dans ces conditions, comprendra-t-on ce que veut dire pour lui le recours à Darlan pour gouverner l’Afrique du Nord. À ses yeux, l’occupation de l’Afrique par les Alliés, ce n’était pas une occupation mais une libération. L’Afrique allait être libérée à la foi- de la menace militaire allemande et de l’occupation des pro Allemands de Vichy. Darlan à Alger, c’est un peu comme si on y avait amené Abetz, avec cette nuance que la France redoute davantage Abetz, mais qu’elle méprise davantage Darlan. A la pointe du combat et de la libération à Alger, le peuple français tout entier attendait de Gaulle, comme il l’attendra à la pointe du combat et de la libération de la France. Et ce qu’on lui accorde à la place, c’est un Darlan honteux. Darlan à Alger, ce n’est pas la victoire pour le peuple français. C’est la défaite dans la victoire. Et voilà pourquoi son cœur saigne en ce moment. Il se demande s’il ne s’est pas trompé en juin 1940, s’il n’a pas eu tort de croire à l’idéal, si ce ne sont pas les cyniques et les réalistes qui avaient raison, et si dans le moment le plus cruel de son histoire, il n’a pas été victime d’une immense illusion ou d’une gigantesque surprise. Sans doute lui a-t-on assuré qu’il ne s’agit que d’un expédient temporaire. Et nous savons que dans son désarroi, cette déclaration lui a été une sorte d’apaisement. Mais ce temporaire jusqu’à quand durera-t-il ? Si Alger a bien valu un Darlan, Paris ne vaudra-t-il pas un Laval ? Voilà ce que se demande avec angoisse le peuple français. J’ai vu qu’on cherchait à le rassurer en lui disant qu’après tout cela n’a pas d’importance puisqu’un jour il se prononcera » en toute souveraineté » sur son destin. Le peuple français n’est malheureusement pas aveugle. Il sait comment se fabriquent certaines » consultations populaires « , comment s’organisent les Munich, à coups de millions, à coups de mensonges, à coups de troubles menaces. Darlan à Alger, les Français savent que c’est précisément le début de la grande manœuvre des pro allemands de Vichy pour fausser d’avance la consultation de la France et pour empêcher l’immense majorité de la France résistante, de la France pro alliée. de s’exprimer clairement et librement « un jour « . Pour Darlan, l’Afrique du Nord est une base de départ. Mais pas contre l’Axe, contre la France qui a résisté malgré lui. Que cela soit toléré, que cela soit favorisé, voilà la stupeur de la France. Et si cette stupeur devait se perpétuer, la France, comme elle a failli le faire aux jours de la défaite, en viendrait à ne plus croire à rien ni à personne.
Voilà ce qu’elle pense.
Darlan à Alger c’est le peuple français sur le chemin du nihilisme.. Un chemin qui peut le mener loin.
Et l’Europe avec lui ! «
Quelques jours plus tard, le 24 Décembre, Darlan était exécuté par un Français patriote, Fernand Bonnier de la Chapelle, qui estimait que la présence de l’Amiral à Alger était un défi à la conscience française et déclarait avant d’être fusillé :
» – J’ai voulu débarrasser la France d’un traître… Je suis content de mourir si ma mort doit servir à rétablir l’unité de la France ! «
Qui oserait soutenir après avoir lu l’article cité ci-dessus que son auteur tournait au fascisme et trahissait le socialisme ? Il entendait au contraire réagir contre les intrigues vichyssoises à Washington et à Londres et soutenir le mouvement gaulliste comme le seul susceptible de rendre à la France l’indépendance dans la dignité et la liberté.
La formation du Conseil National de la Résistance
C’est dans cette intention que sous le nom de Brumaire Pierre repart pour le territoire français en Février 1943. Le général de Gaulle vient de rentrer à Londres, de la Conférence qu’il a tenue à Casablanca du 14 au 26 Janvier avec MM. Churchill et Roosevelt. La situation politique reste confuse : il faut mettre fin aux divisions entre Français, créer des liens solides entre les diverses organisations de résistance dont les efforts sont trop souvent divergents, prévoir en France métropolitaine un gouvernement capable d’agir indépendamment au cas où il y aurait une coupure avec le gouvernement d’Alger. envisager la mise en place des Secrétaires Généraux et l’organisation des services ministériels. Pierre Brossolette étudiera sur place toutes ces questions pour le Comité National.
Au début de 1943, quand il revient ainsi pour la deuxième fois sur le territoire français, où en est la Résistance ? En zone Sud où les Allemands ont pénétré le 11 Novembre 1942, elle a été décapitée en quelques semaines, mais elle se reconstitue rapidement avec de nouveaux éléments. L’unification des trois groupes principaux : Libération, Combat et Franc-Tireur, avait commencé par la fusion de leurs éléments militaires qui devinrent l’Armée secrète (A. S.). Au début de 1943, ces trois groupes constituent les Mouvements Unis de Résistance (M. U. R.).
En zone Nord. l’éparpillement est resté beaucoup plus marqué. Nombre des petits groupes du début, décimés, ont disparu. Parmi ceux qui ont subsisté et qui réussiront à se perpétuer jusqu’à la Libération figurent : Libération Nord. et l’Organisation civile et Militaire (anciens groupes Arthuys et Touny) avec lesquels Pierre Brossolette avait déjà pris contact avant son premier départ en Angleterre, Ceux de la Libération, Vengeance, Ceux de la Résistance, Résistance, Défense de la France, enfin le Front National avec ses Francs-Tireurs et Parti-sans. Beaucoup des membres de ces mouvements tenaient à leur autonomie, en raison de la diversité de leur recrutement.
Pierre Brossolette avait, à Londres nous l’avons vu, mis en évidence l’importance de cette résistance, souvent méconnue par l’entourage – tout militaire – du Général de Gaulle qui mettait l’accent sur les réseaux de renseignements et les lignes d’évasion, organisés par des officiers envoyés de Grande-Bretagne par la France libre. Il avait souligné le rôle du facteur politique, également trop dédaigné à Londres, mais qui avait une importance certaine dans les aspirations de la plupart des mouvements intérieurs. Le but qu’il se donnait était de rassembler toutes les familles variées de cette Résistance et nul n’a travaillé dans ce sens avec e plus de continuité et de clairvoyance « .
On a pu dire que la mission qu’il accomplit en France au début de 1943 revêtait, du point de vue intérieur français, ainsi que du point de vue international, un caractère essentiel.
» Brossolette a tendu de toute sa volonté au ralliement de toutes les forces de la Résistance française autour du général de Gaulle, car il lui paraissait indispensable de montrer aux Alliés que la France était unie derrière celui-ci, en tant que représentant de la légalité française. En effet, les Alliés faisaient deux objections principales à la reconnaissance effective du gouvernement de Gaulle. La première venait de ce que le général avait pris, dès le début, vis-à-vis des Anglo-Saxons, une position telle qu’il risquait de faire figure d’ambitieux visant au pouvoir personnel. La seconde était qu’il y avait en France des éléments politiques anti-gaullistes, cette seconde objection venant épauler la première. Pour conférer au Comité de Londres une légitimité républicaine et pour donner du même coup à la France le prestige lui permettant de négocier avec les Alliés, il fallait donc les convaincre que toutes les fractions de l’opinion représentées par la Résistance française étaient, en quelque sorte, d’allégeance gaulliste. Or, il y avait deux obstacles à vaincre en France même ; le premier était représenté par la dissidence giraudiste, composée, en général, d’éléments tard venus à la Résistance, presque tous militaires ; le deuxième, beaucoup plus sérieux, était constitué par les éléments de gauche, communistes en particulier, qui avaient été depuis le début, une des grandes forces de la Résistance. En rassemblant autour de de Gaulle toutes les familles politiques de la France de 1939 et de la France résistante, le gain était double. De Gaulle, entouré de délégués des grands partis politiques et de délégués issus des mouvements de résistance, recevait aux yeux des Alliés une sorte d’investiture démocratique et, aux yeux de la Résistance intérieure, revêtait un aspect de légitimité que viendrait encore fortifier sa reconnaissance officielle par les Anglo-Américains. Cet ensemble de considérations indique dans quel sens s’exerça l’influence de Brossolette pendant son séjour en France, dans les premiers mois de 1943 « .
Pierre Brossolette est déposé par avion en zone sud au début de février et arrive à Paris le 15. Peu après, il est rejoint par le colonel Passy (Antoine, ou encore Arquebuse) chargé de l’organisation centrale militaire secrète et par le capitaine anglais Shelley, ardent ami de la France, par qui dans la suite M. Churchill put être directement renseigné sur les possibilités et les besoins de la Résistance. Pendant près de deux mois, les trois hommes circulent soit ensemble, soit isolément dans la capitale. Pierre Brossolette, dont le signalement a été donné à toutes les polices : allemande, milicienne et vichyssoise, a laissé pousser sa moustache et se coiffe à plat avec la raie sur le côté, ce qui le rend difficilement reconnaissable ; il use fréquemment du vélo-taxi, moyen de transport discret. Dans les multiples contacts qu’il lui faut prendre, il se heurte à de grosses difficultés en raison d’une part des arrestations qui se multiplient et qui font craindre que réunir tous les chefs de la Résistance en un seul organisme leur fasse courir trop de risques ainsi que, par suite, à la Résistance elle-même ; et d’autre part de ce fait que certains chefs se trouvent à Londres pendant qu’il est à Paris.
Le premier résultat de ses prises de contact fut la création, pour la zone nord, d’un comité de coordination groupant les chefs des cinq plus importants mouvements : O. C. M. (Langlois), Libé-Nord (Charles Laurent). C. D. L. L. (Médéric), F. N. (Villon), C. D. L. R. (Lecompte-Boinet). Il rencontra ensuite Jean Moulin (Max), délégué du général de Gaulle pour la zone sud, en vue de créer un organisme unique, qui, en liaison avec Alger et Londres, représentât officiellement la Résistance des deux zones.
Les hommes de la Résistance étaient en général opposés à l’introduction de représentants des partis politiques dans cet organisme. Il fut cependant relativement aisé pour Brossolette de faire admettre la représentation du Parti Communiste au sein du Conseil en formation, étant donné la valeur de la contribution apportée par ce parti à la Résistance.
Il en fut de même pour le Comité d’action Socialiste (C.A.S.). Plus difficiles furent les négociations au sujet des autres partis que la politique vichyssoise avait plus profondément désorganisés ou divisés. L’insistance de Brossolette qui estimait avec Max que ces partis politiques auraient plus d’audience auprès des Alliés, dont ils étaient connus, que l’anonyme Résistance Intérieure, triompha de toutes les objections. Issus l’un et l’autre de cette Résistance Intérieure, ces deux hommes pouvaient mieux que d’autres représentants de la Résistance Extra Métropolitaine réussir cette délicate mission auprès de leurs camarades restés sur le sol national.
Quand Pierre Brossolette quitte à nouveau le sol français, en mai, par un avion qui le prend à son bord aux environs de Rouen, l’union des mouvements de zone nord et de zone sud était faite.
Ainsi fut formé le Conseil National de la Résistance qui, présidé par Max, allait se réunir pour la première fois à Paris le 27 mai 1943 et voter la motion rédigée par Georges Bidault, dans laquelle le C.N.R. » s’affirmait certain d’interpréter la volonté de toute la nation en déclarant, au nom de la Résistance française unanime, nuls et non avenus tous les actes du gouvernement de Vichy qu’elle n’avait jamais reconnu, faisait confiance au Comité français de Londres et au Général de Gaulle, en particulier, pour établir un gouvernement national fondé sur des principes républicains et démocratiques, et le chargeait de gérer les intérêts de la nation française… «
M. Lecompte-Boisnet qui assistait à cette réunion rapporte ainsi ses impressions, dans Volontés de C.D.L.R. du 31 janvier 1945 : » À ce moment nous eûmes vraiment conscience d’accomplir un acte historique d’une très haute portée nationale : en effet, dans cette salle à manger banale, à la barbe de l’ennemi qui nous entourait et nous traquait, dix-sept hommes de bonne volonté avaient accepté de se substituer à un pouvoir que la France tout entière rejetait.
» Nous avions le sentiment d’incarner la volonté de la nation enfin réconciliée avec elle-même et unanime. Nous acceptions, au nom de la nation, un gouvernement qui s’était imposé par sa clairvoyance et son sens national.
» Répétées par les radios de Londres et de New-York, ces décisions eurent une influence certainement décisive sur le cours des événements.
» La France, ligotée, savait enfin que sur son sol même, des hommes, représentants des centaines de milliers de Français résistants, avaient pris en main ses intérêts et travaillaient dans l’ombre pour elle. La Résistance, officialisée, redonna confiance aux Français qui se sentaient soutenus en France même. C’était psychologiquement un fait très important ; sans compter que le C.N.R. portait dans son sein la future Assemblée consultative, et que le Général de Gaulle possédait enfin les bases juridiques sur lesquelles il pouvait asseoir son gouvernement pour libérer le sol national, vaincre l’ennemi et reconstruire la France… »
Si nous nous permettons de citer ces lignes c’est parce qu’elles précisent excellemment la portée nationale et internationale de cette création du Conseil National de la Résistance que Pierre Brossolette appelait de tous ses vœux depuis trois années et à la constitution duquel il n’avait cessé de travailler de toute son intelligence et de tout son cœur.
Il avait couru de gros risques, certes, allant de rendez-vous en rendez-vous prendre de dangereux contacts avec ceux qui, dans la Résistance, étaient eux-mêmes les plus surveillés et l’on peut dire que, durant ces trois mois, s’il ne fut pas pris, c’est à une suite de hasards heureux. de miracles toujours renouvelés qu’il le doit, dit M. Lecompte-Boisnet, qui ajoute : » Certains hommes de la Résistance ont eu peu de mérites à être courageux : ils n’étaient pas toujours conscients de tous les dangers qu’ils couraient. Chez Brossolette, au contraire, chaque fois qu’il quittait Londres, son imagination extraordinaire lui faisait vivre toutes les tortures qu’il aurait un jour à subir, et même les plus petits détails de ces tortures. Là était le véritable courage, et son sacrifice fut vraiment et librement et volontairement consenti… «
Le Général de Gaulle ne se trompe pas sur l’importance des résultats obtenus au prix de si gros risques, et le 25 avril 1943, le Chef de la France combattante, Président du Comité National, cite à l’ordre des Forces Françaises libres, le Commandant Brossolette, pour le motif suivant :
Officier d’une rare énergie et d’une ténacité remarquable. Faisant preuve d’un mépris total du danger, a contribué avec un plein succès à l’organisation de la résistance en France et à l’union de tous les Français contre l’envahisseur. «
Cette citation comporte l’attribution de la Croix de guerre avec palme de vermeil.
Dans le même temps, le gouvernement de l’anti-France enlevait à Pierre Brossolette la nationalité française ainsi que la croix de guerre gagnée au cours des opérations militaires contre les Allemands.
Hommage aux Morts de la France Combattante
Des son arrivée à Londres, Pierre Brossolette continue sa propagande et son action. Pendant deux mois, il supplée à la B.B.C. le » porte-parole de la France combattante « , Maurice Schumann, appelé à Alger. Le speaker l’annonce par ces mots : » Un officier des Forces Françaises Combattantes décoré de la Croix de la Libération vous parle… » Ses amis français le reconnaissent non seulement à sa voix mais à la flamme qui l’anime et à l’ardeur de ses appels. Sa tâche est difficile d’ailleurs car il est souvent gêné par les consignes et par la double censure qu’exercent sur toutes les émissions Américains et Anglais. En mai, notamment, elle fut particulièrement délicate en raison des tractations que le général Giraud poursuivait à Washington où l’action gaulliste continuait à rencontrer une vive opposition dans certains milieux. Pierre Brossolette n’en clame pas moins dans ses vibrants éditoriaux sa foi en une prochaine délivrance d’une France » une et indivisible « , libre et démocratique, à la renaissance de laquelle présidera le premier de ses Résistants, le Général de Gaulle.
Et le 18 juin 1943, à l’Albert Hall, énorme rotonde construite sous le règne de Victoria et où alternent en temps normal les concerts classiques et les combats de boxe, il prononce, au cours d’une manifestation organisée par l’Association des Français de Grande-Bretagne pour commémorer le premier appel du général de Gaulle, l’allocution suivante qu’on ne lira pas sans émotion étant donné le sort qui devait être bientôt hélas ! celui de l’orateur :
Français de Grande-Bretagne, Français combattants,
L’histoire de notre pays n’est qu’une suite de prodiges qui s’enchaînent : prodige de Jeanne d’Arc, prodige des soldats de l’An II, prodige des héros de la Marne et de Verdun. Voilà le passé de la France. Ma mission est ce soir de rendre hommage à ceux par le prodige desquels la France conserva un présent et un avenir, les morts de la France combattante.
De tous les morts dont la chaîne innombrable constitue notre trésor de gloire, ceux-là, plus qu’aucuns autres, incarneront, dans sa pure gratuité, l’esprit de sacrifice. Car ils ne sont point morts en service commandé : un chiffon de papier signé, par dérision, dans la clairière de Rethondes, les avait déliés du devoir de servir. Ils ne sont point morts volontaires pour une mission qu’on leur offrait : un pouvoir usurpé ne demandait des volontaires que pour l’abdication. Ce sont des hommes à qui la mort avait été interdite sous peine capitale, et qui ont dû pouvoir la braver pour pouvoir la briguer. L’Histoire un jour dira ce que chacun d’eux a dû devoir accomplir pour retrouver dans la France combattante son droit à la mort et à la gloire. Elle dira quelles odyssées il leur a fallu vivre pour s’immortaliser dans leurs Macles ! Passagers clandestins des derniers bateaux qui se sont éloignés de la France terrassée, humbles pêcheurs franchissant sur des barques les tempêtes de la Manche, marins et coloniaux ralliant des convois ravagés par la torpille, risque-tout affrontant les Pyrénées, prisonniers évadés des camps de l’ennemi, détenus évadés des bagnes de la trahison, il a suffi qu’en ces jours de juin dont nous fêtons l’anniversaire un homme leur ait crié : » Je vous convie à vous unir avec moi dans l’action, dans le sacrifice et dans l’espérance « , pour qu’ils se lèvent tous, pour que ceux qui n’appelaient plus la mort que comme une délivrance, accourent y chercher un accomplissement, et pour que, d’un seul geste, sortant du banal ils entrent dans le sublime.
Et voici maintenant que dans le ciel limpide de leur gloire, ils se parlent comme les sommets se parlent par-dessus des nuées, qu’ils s’appellent comme s’appellent les étoiles. Entrés déjà dans la légende ou réservés pour l’histoire, les morts prestigieux de Mourzouck et de Bir Hakeim répondent aux morts stoïques de la Marine Marchande ; tombés sous le drapeau déployé d’El Alamein et d’El Hamma, les soldats de Leclerc et de Kœnig répondent aux marins qui ont coulé, sous le pavillon haut de l’Ulysse, du Rennes et du Mimosa ; foudroyés dans ce dixième de seconde où les yeux peuvent fixer les yeux de l’adversaire, les pilotes de nos groupes et de nos escadrilles répondent aux sous-mariniers du Surcouf et du Narval, à qui une lente agonie a fait attendre encore la mort après qu’ils l’eurent trouvée. Et là-bas dans la nuit du martyre et de la captivité, la voix pathétique qui leur répond, c’est la voix des morts du combat souterrain de la France, élite sans cesse décimée et sans cesse renaissante de nos réseaux et de nos groupements, otages massacrés de Paris et de Châteaubriant, fusillés dont les lèvres closes sous la torture ne se sont descellées qu’au moment du supplice pour crier » Vive la France ! «
Ce qu’ils étaient hier, ils ne se le demandent point l’un à l’autre. Sous la Croix de Lorraine, le socialiste d’hier ne demande pas au camarade qui tombe s’il était Croix-de-Feu. Dans l’argile fraternelle du terroir, d’Estienne d’Orves et Péri ne se demandent point si l’un était hier royaliste et l’autre communiste. Compagnons de la même Libération, le Père Savey ne demande pas au lieutenant Dreyfus quel Dieu ont invoqué ses pères. Des houles de l’Arctique à celles du Désert, des ossuaires de France aux cimetières des sables, la seule foi qu’ils confessent, c’est leur foi dans la France écartelée mais unanime.
Colonels de 30 ans, capitaines de 20 ans, héros de 18 ans, la France combattante n’a été qu’un long dialogue de la jeunesse et de la vie ; les rides qui fanaient le visage de la Patrie, les morts de la France combattante les ont effacées ; les larmes d’impuissance qu’elle versait ils les ont essuyées ; les fautes dont le poids la courbait, ils les ont rachetées. En cet anniversaire du jour où le Général de Gaulle les a convoqués au banquet sacré de la mort, ce qu’ils nous demandent, ce n’est pas de les plaindre, mais de les continuer. Ce qu’ils attendent de nous, ce n’est pas un regret, mais un serment ; ce n’est pas un sanglot mais un élan !
Français qui êtes ici, debout pour les morts de la France combattante ! «
Une Mission qui se prolonge
Le 13 août 1943, convoqué par le Général de Gaulle, arrivé en mai en Afrique du Nord libérée » pour réaliser l’unité de l’Empire français dans la guerre « , Pierre Brossolette part en bateau pour Alger. Il n’y reste que quelques semaines, un peu désemparé par les remous qu’il y constate. Et puis la tâche n’est pas terminée : il reste encore en France beaucoup à faire. Le Général de Gaulle hésite toutefois à le charger d’une nouvelle mission : il sait les dangers que courent les Résistants du sol métropolitain et plus particulièrement ceux dont le rôle est de prendre de nombreux contacts et qui doivent par suite multiplier les déplacements. Mais Pierre Brossolette insiste et obtient satisfaction. Il quitte Alger en avion le 19 septembre chargé cette fois de mettre au point tout ce qui concerne la Presse, la Radio et le Cinéma et aussi d’installer un nouveau Délégué général, Max arrêté ayant disparu.
» Voici l’éternel revenant « , dit sa secrétaire en le voyant arriver une fois de plus dans la capitale ! Comme à chacun de ses voyages, Pierre Brossolette prend les premiers jours beaucoup de précautions, puis s’enhardit peu à peu ; il a confiance dans son étoile : à Paris, il est tabou, dit-il en riant aux amis qui l’abritent. Ce n’est d’ailleurs pas ignorance mais accoutumance du danger.
Avant que sa présence ne soit connue de la Gestapo, – ce qui à chacun de ses séjours à Paris ne demande que peu de jours, – il tient à rencontrer sa sœur qui le trouve un peu préoccupé mais toujours ardent et confiant. Ses dernières paroles furent pour lui dire que si elle apprenait que son frère était arrêté sous sa véritable identité, elle ne le reverrait pas vivant. » Je sais trop de choses, ajouta-t-il et je connais trop de gens. On voudra me faire parler. J’ignore si les procédés de torture qu’on emploiera très certainement n’auraient pas raison de moi : or comme je ne veux livrer personne, le mieux est que je disparaisse avant même qu’on m’interroge : j’en ai les moyens ! «
Le frère et la sœur ne devaient plus jamais se revoir. L’un et l’autre étaient trop surveillés pour pouvoir tenter une nouvelle entrevue…
Pierre Brossolette se met immédiatement au travail. Ses journées commencent à cinq heures du matin et s’achèvent tard dans la nuit. Il remplit sa mission sur la presse, rencontre le nouveau délégué général, Bollaert, l’initie aux secrets de la Résistance, lui déblaie le terrain puis, élargissant comme à chacun de ses voyages la mission dont il est chargé, prend contact avec les chefs de la plupart des organismes de Résistance et examine avec eux les possibilités d’action militaire. Il a retrouvé pour quelques semaines son ami le capitaine anglais Shelley venu de Londres et, seul ou en sa compagnie, il multiplie les visites, les démarches, toujours joyeux et plein d’entrain.
Mlle Blocq-Mascart dont il avait fait la connaissance à son voyage précédent, rapporte comme suit l’impression qu’il lui fit à ce troisième voyage peu après son arrivée à Paris :
» Pierre était coiffé en brosse, avait les cheveux poivre et sel et la moustache rasée, il avait l’air d’un collégien en vacances. Comme je le plaisantais sur sa coiffure : » Mon coiffeur a dit que j’avais la plus belle brosse qu’on puisse trouver, me répondit-il en riant, et que c’était un véritable plaisir de coiffer une brosse comme celle-là. Est-ce que je ne vous plais pas comme ça ? » Je l’assurai que je le trouvais beaucoup mieux qu’avant ; en réalité, si je n’avais su que c’était lui, je ne l’aurais pas reconnu. Il avait changé même de façon de s’habiller, et avait remplacé le complet sérieux par des pantalons de golf. Il parla du débarquement, qu’il attendait pour les mois à venir, et de la guerre. Je lui dis alors, pensant au débarquement que nous attendions tous avec tant d’espoir : » Vous devriez bien vous dépêcher de venir « . Il se mit à rire : » Qui ? Nous ? » – » Eh bien » Vous « , » Eux « , les Français et les Alliés ! » – Ce sera bientôt « , promit-il. Avant de nous séparer, il me demanda de venir déjeuner avec lui un jour et j’acceptai bien volontiers.
Pierre vint me chercher chez les gens chez qui j’habitais et m’emmena déjeuner près de l’Odéon, au Marabout, je crois. Nous étions seuls dans la salle du fond. Nous parlâmes longuement des études que je voulais faire, de ses cours de préparation aux Chartes à Sévigné, au début de la guerre ; de la vie clandestine, de ses enfants restés à Londres et dont il voulait me faire faire la connaissance, et naturellement, des événements.
Plusieurs fois, il fit allusion aux dangers qu’il courait, mais sans dramatiser. » La vie est un cirque, disait-il, il faut savoir s’y amuser ; la plupart des gens manquent de » sense of humour » et se compliquent la vie inutilement « .
Après le déjeuner, il devait aller contacter » quelqu’un et nous nous séparâmes au métro Odéon. Je ne devais plus jamais le revoir… «
C’est vers ce moment que, traqué lui-même et obligé à de multiples précautions, il n’hésite pourtant pas à traverser tout Paris en apprenant que son jeune neveu était menacé d’arrestation (les chefs du Réseau où celui-ci travaillait ayant été livrés par un traître) pour avoir de ses nouvelles et apporter, rue Madame, à des amis qui les transmettraient à sa sœur les conseils qu’il puisait dans son expérience de la vie clandestine.
Ainsi malgré les périls qui le menaçaient, Pierre gardait au surplus toute sa liberté d’esprit. Dans ses heures de loisir, il étudie même la philosophie et entreprend un important travail sur le marxisme travail dont. – on verra plus loin pourquoi, – il ne reste hélas ! d’autre trace que la lettre suivante écrite à des amis en vue de leur demander un travail de recherche bibliographique qu’il estimait indispensable, lettre que nous nous permettons de citer pour témoigner de sa persistante activité intellectuelle :
» J’ai été frappé depuis très longtemps et surtout depuis la guerre, de l’erreur commise aussi bien par le libéralisme que par le marxisme dans la mesure où ils affirment la primauté de l’économique sur le politique. J’ai le sentiment qu’il y a dans toute la vie des peuples un côté passionnel qui ne s’explique ni par les intérêts immédiats ni par l’élaboration de ces intérêts sous la forme de passions matérialistes. Il y a des instincts de domination, de révolte, de refus, etc., qui tiennent à des racines de l’être plus profondes que l’intérêt alimentaire. Nous l’avons éprouvé pathétiquement dans toutes les grandes crises de ces dernières années (Munich, la Guerre, l’Armistice, la Résistance…) où c’est l’être tout entier qui a » donné » en chacun de nous.
Que ce thème soit judicieux ou non, là n’est pas le débat. C’est ainsi que je sens les choses, et pour moi, c’est l’essentiel. Mais ceci m’entraîne à la considération suivante : libéralisme et marxisme sont au fond des théories issues du rationalisme du XVIIIe siècle ; l’homme n’y est mesuré que par du quantitatif ou du spatial (besoins, travail, etc.)… L’élément passionnel irréductible et inanalysable qui donne les grands sursauts individuels et collectifs, y est complètement négligé ou n’y est considéré que comme un épiphénomène ou un reflet des intérêts matériels. À cet égard, la pensée politique européenne (exception faite du nazisme qui est une maladie réactionnelle) est en retard de cinquante ans sur la pensée philosophique et littéraire (de Barrès à Proust, Lawrence et Faulkner, et de Bergson à Freud).
» Dans cette démonstration, j’ai bien en mains les points essentiels. Mais je n’ai pas le temps ni surtout les moyens de traiter les points suivants :
» a) Le marxisme est un aboutissement du rationalisme. Le montrer historiquement par les sources de Marx (les » économistes » d’une part, Hegel et les » idéalistes » allemands de l’autre). Le montrer substantiellement par une analyse (sommaire) de la conception de l’homme et de l’esprit à travers l’œuvre de Marx.
» b) Les marxistes ont si bien senti ce qu’avait d’insuffisant ce qu’on a appelé leur » matérialisme » et ce qui est en réalité leur » atomisme rationaliste « , qu’ils ont essayé de construire une philosophie, voire une morale rétablissant le caractère humain de notre vie : c’est la tentative qu’on a appelée l’humanisme marxiste.
» J’aimerais avoir :
» 1° Une analyse de cet humanisme un peu plus développée que le simple résumé qu’en voici : » Le XVIIIe siècle en brisant à la fois les entraves et les cadres (corporations, etc. …) de la vie des hommes a mis l’individu seul en face de lui-même. Le seul moyen pour lui de retrouver des solidarités qui l’empêchent de se sentir malheureux, c’est le sentiment de classe, le sentiment d’appartenir à une collectivité, etc. … « .
» 2° Un jugement sur cette tentative… J’aimerais avoir sur ce sujet un dossier du pour et du contre.
Il doit y avoir sur les deux points quelques ouvrages où l’on doit pouvoir trouver quelque chose (les Éditions Sociales Internationales – E.S.I. – et la maison de la Culture étaient les grands tenants de l’humanisme marxiste). Il y a aussi de bons articles de Maublanc, – sur Hegel et Marx notamment – qui ont été publiés soit isolément soit en volume. Une rapide recherche bibliographique doit permettre de retrouver ça… «
On voit de quelle nature étaient les distractions d’un homme qui par ailleurs devait sans cesse rester sur le qui-vive, fixait ses rendez-vous dans l’arrière-boutique d’un petit café ou sur le trottoir d’une avenue écartée, changeait chaque soir de gîte et devait mobiliser parents et amis pour obtenir d’eux par les moyens les plus indirects quelque ravitaillement. Tout cela afin de remplir la mission qui lui avait été confiée au mieux des intérêts de son pays. Il a ainsi (le multiples entretiens au cours desquels une fois débattus les problèmes urgents, on abordait des questions d’ordre général : dans la discussion, – nous en avons eu de nombreux témoignages, dont celui de M. Parodi, l’ancien ministre du Travail, alors clandestin et chargé de mission lui aussi – Pierre Brossolette déployait les plus brillantes qualités intellectuelles…
Les rendez-vous qu’il donne ne sont pas toujours couronnés de succès. C’est ainsi qu’il écrit le 2 décembre 1943 à un de ses amis socialistes, alors clandestin comme lui et depuis député à l’Assemblée Constituante :
» Je suis désolé : je n’ai pas pu trouver l’endroit où tu m’avais donné rendez-vous hier. Tu m’avais écrit : » Le canon de la Bastille « , coin de la rue Béranger. » J’ai trouvé la rue Béranger, elle est à la République. Elle a quatre coins, deux rue du Temple et deux rue de Turenne. Aucune ne comporte de » Canon de la Bastille « . J’ai cherché dans l’Annuaire du Téléphone : rien. Je me suis transporté à la Bastille et j’ai erré tout autour de la place : j’ai dénombré le Clairon, le Tambour, le Rex, le Dupont, les 4 Sergents, la Chope, etc., mais pas de Canon. De guerre lasse, au bout d’une heure, j’ai abandonné la partie. Je dois avoir été idiot pour n’avoir pu te trouver : mais c’est tout de même comme ça. Et j’en suis fichtrement déçu ! «
Mais la mission est remplie. Les responsables sont installés à tous les postes, la relève est prête. L’heure est venue de regagner Londres puis Alger afin d’assurer de nouvelles tâches. Déjà le capitaine anglais Shelley est reparti en novembre pour l’Angleterre (le message : de Neptune à Hippocampe…)
Le départ est fixé à la lune de décembre. Pierre Brossolette se rend dans le Nord au rendez-vous arrêté. Deux avions devaient venir : le premier est abattu par les Allemands ; le second n’arrive pas à trouver le terrain d’atterrissage. L’opération est manquée. Une heure après le départ de Pierre, le propriétaire de l’abri où il avait attendu vainement est arrêté. C’est alors que commença une longue période de mauvais temps : vent, pluie, brouillard, rendant impossible toute opération aérienne. Les Français à l’écoute de la B.B.C. purent durant cette période entendre plus d’une fois l’indicatif : » de Minos à Rhadamante… « . Pierre Brossolette s’impatiente. Il cherche un autre moyen de franchir la Manche. La résistance bretonne le lui fournit. Elle est en train de monter une » opération » avec un bateau à moteur, – le Jouet des Flots – ; une véritable expédition est organisée : elle comprend, outre son commandant, un officier de marine spécialiste de ce genre d’opérations, le patron et son équipage ; un groupe d’aviateurs anglo-américains tombés sur le sol français en parachute lors d’attaques aériennes ; un émissaire des services du Ravitaillement de la France libre porteur d’un dossier contenant le détail des approvisionnements nécessaires à la vie courante du pays si les. Allemands dans leur retraite emportaient les stocks et détruisaient les récoltes, ainsi que l’indication des matières premières et du matériel indispensables à la remise en marche des secteurs essentiels de l’économie ; le Délégué général du Comité National, M. Bollaert, aujourd’hui Commissaire de la République à Strasbourg, qui partait avec Pierre pour Alger : au total trente-cinq à quarante personnes.
C’est dans la nuit du 2 au 3 février 1944 que le Jouet des Flots quitta la côte bretonne aux environs de Loctudy. Le temps était très mauvais : le vent soufflait en tempête et la mer était démontée : mais impossible d’ajourner le départ sans faire courir les plus grands dangers aux passagers rassemblés dans des parages étroitement surveillés par la police allemande.
Le bateau emportait une provision d’essence suffisante pour aller jusqu’à la côte anglaise mais en fait, un rendez-vous avait été fixé au large d’Ouessant avec une vedette britannique qui devait, après transbordement des passagers, assurer la fin du voyage.
Les effets du mauvais temps se font rapidement sentir : d’une part le mal de mer terrasse passagers et équipage ; d’autre part le bateau pourtant éprouvé et en bon état commence à faire eau. Les passagers sont si malades qu’ils sont dans l’impossibilité de manœuvrer la pompe du bord. Quant au moteur, on ne peut lui demander plus que la propulsion du bateau. Circonstance aggravante : brusquement, par suite du violent pilonnage des paquets de mer ou peut-être du talonnage du navire sur un des innombrables écueils des parages de cette fin de terre, c’est une véritable voie d’eau qui se déclare. La situation devient tragique. Pierre Brossolette retrouve son âme de chef et réussit à obtenir que ses camarades pompent à tour de rôle. Mais il est trop tard pour pouvoir espérer gagner le large d’Ouessant. Dans la cale l’eau monte toujours et bientôt le moteur est noyé. Poussé par les courants, voici le bateau sur la Chaussée de Sein ; on essaie de jeter l’ancre malgré les fonds rocheux qui s’y opposent le plus souvent. L’ancre parvient à s’accrocher dans une fissure de rocher et on profite du répit pour hisser la voile : le bateau ne gouverne plus et le niveau de l’eau s’élève dans la cale : c’est le naufrage à brève échéance. Il faut se résoudre au plus vite à regagner la côte malgré les risques à courir. Tous les papiers et objets compromettants sont jetés à la mer. Pierre Brossolette y lance également le manuscrit fruit de ses dernières veilles.
On met le cap sur la Pointe du Raz. En l’absence de rames, il faut se fier à la voile. Et tandis que les gros nuages noirs qui s’effilochent au-dessus du cap laissent passer la première clarté de l’aube, le bateau s’aidant plus encore de l’ancre que de la voile finit par accoster au sud du promontoire tandis que sur la côte, en faction près de leur mitrailleuse, les Allemands ne prêtent aucune attention à cette grosse barque de pêcheurs qui fuit la tempête…
Pour gagner la terre ferme, il faut en raison de la profondeur, utiliser le mât pour jeter une sorte de pont entre le bateau et la côte. Du moins passagers et matelots atteignent-ils sans encombre le » plancher des vaches « . Après avoir échappé à la tempête et à l’océan, il faut maintenant échapper aux Boches…
À Plogoff, l’aubergiste et sa famille, aidés des habitants, cachent les fugitifs que recherchent des patrouilles. Les naufragés s’égaillent, partent par petits groupes. Pierre Brossolette reste avec Bollaert ; une auto vient de Quimper les chercher à la tombée du jour. Les papiers du conducteur de la voiture sont en règle. Mais les deux voyageurs n’ont pas le laissez-passer nécessaire pour circuler dans la zone côtière. Pour ce péché, assez véniel, un barrage les arrête à Audierne. De là, non identifiés, ils sont envoyés à la prison de Rennes.
Rendez-vous avec la Mort
De la prison, Pierre Brossolette trouve la possibilité d’alerter dès le 3 février son réseau parisien. Un des agents du B. C. R. A. qui partait pour Londres, en avion cette fois, y emporte la mauvaise nouvelle, tenue soigneusement secrète.
À la prison de Rennes, les deux captifs, d’ailleurs séparés l’un de l’autre, ne semblent pas avoir été autrement inquiétés ni malmenés. Sans doute les prend-on tout d’abord pour de quelconques Français cherchant à rejoindre Londres. Pierre Brossolette est dans une cellule avec plusieurs autres détenus qui, accusés de chose de peu d’importance, attendent avec philosophie leur interrogatoire et leur libération. » Leurs plus grands moments de cafard consistent à regretter les pantoufles et les épouses perdues ainsi que l’apéritif des jours de liberté ! Pour le reste toute l’attention est concentrée sur l’amélioration de l’ordinaire et l’idée de se tirer d’ici apparaît comme une fantaisie un peu ridicule et assez encombrante « , écrit-il, mais tout de suite après il ajoute : » je ne capitule pas pour ce qui me concerne « .
Car, contrairement à ce qu’il avait confié à sa sœur en septembre, il semble qu’il ait été décidé à jouer ses chances jusqu’au bout. Dans une autre lettre datée du 13 février, il écrit : » Je ne me dissimule pas un instant que je suis en train de manger mon pain blanc et qu’incessamment vont commencer des épreuves autrement redoutables. Mais j’y suis résolu. Quand nous avons été » fabriqués « , j’ai réfléchi très vite pour savoir si j’emploierais les grands moyens dont j’étais muni. Mais j’ai conclu que ce serait ipso facto aggraver le cas de tous les autres et j’ai adopté l’autre ligne de conduite. Il faut maintenant la suivre jusqu’au bout. «
Jusqu’au 8 mars, ses lettres se succèdent, transmises dans un panier à linge. Il y donne des indications précises pour lui adresser des réponses et pour lui fournir les instruments qui pourraient lui permettre l’évasion à laquelle il ne cesse de penser : une montre, du chloroforme, des scies à métaux flexibles…
Dans le même temps, on étudie de l’extérieur, les moyens de le libérer. La Résistance est alertée. » Il faut sauver Brossolette « , tel est le mot d’ordre. D’Angleterre même. le capitaine Shelley arrive par avion spécial et se rend à Rennes pour tenter tout ce qui peut être fait. Divers plans sont échafaudés et on va jusqu’à projeter, si nécessaire, un assaut de la prison.
Malheureusement, le capitaine Shelley est arrêté à Paris, et dans le même temps, la situation s’est modifiée à Rennes où un resserrement général a rendu de plus en plus difficiles les contacts de Pierre Brossolette avec l’extérieur. A partir du 8 mars, c’est le silence total.
Le 16 au soir, M. Bollaert est extrait de sa cellule, amené à la Gestapo et interrogé : » Que faisiez-vous avec Brossolette ? » Il apprend ainsi que les Allemands viennent de les identifier tous les deux. Ignorés dans leur prison, ils ont été repérés à la suite de l’arrestation à la frontière espagnole d’un courrier portant à Londres une relation détaillée de Bingen, délégué général adjoint de la zone nord, sur leur départ en bateau, leur arrestation, leur détention à Rennes. Alertés, les Allemands n’ont pas eu de peine à les découvrir sous leurs noms de guerre : Brumaire et Baudoin.
On a dit que Pierre avait été identifié à Paris, que la mèche blanche qu’il avait au milieu de sa chevelure noire avait permis à un inspecteur de police de le reconnaître… Cette version, répandue durant les derniers mois de l’occupation, apparaît controuvée à la lumière des témoignages précis émanant de déportés rentrés d’Allemagne après la victoire.
Reconnu, Pierre est perdu : il connaît toute l’organisation de la Résistance, les noms, les dispositions prises, les centrales… Rien ne sera épargné pour le faire parler. Il le sait. Il sait la fin de Jean Moulin (Max) mort l’été d’avant dans les tortures. Il sait la fin de Scamaroni, en Corse, qui, après deux jours d’atroces traitements, a réussi à s’ouvrir la gorge avec un fil de fer trouvé dans sa cellule, parce qu’il sentait qu’il ne pourrait vraisemblablement résister à de nouveaux supplices. Il a souvent évoqué leur sort. Il est prêt à mourir pour ne rien livrer de ce qu’il sait…
Le 18, il quitte Rennes dans une conduite intérieure, enchaîné à M. Bollaert. sous la garde de deux policiers. On arrive avenue Foch où les deux amis passent la nuit, toujours rivés l’un à l’autre et attachés à leurs chaises sans pouvoir échanger autre chose que quelques mots à voix basse. Sans doute, au cours de cette nuit, a-t-il examiné les lieux – il n’y a pas de barreaux aux fenêtres de cette salle située au 5 étage – et pris sa résolution. Interrogé le 19, ainsi que M. Bollaert, par les procédés habituels – la schlague et la baignoire, – il est le 20 écroué à Fresnes. Pierre Brossolette, avec un groupe d’entrants, passe à la douche. Il reconnaît un jeune homme qui travaillait au B.O.A. et qu’il avait rencontré lors de ses départs clandestins en avion. Il peut parler avec lui quelques minutes sous la douche : c’est la dernière personne qui l’entendra. Il lui confie comment il a été identifié et lui parle d’un livre qu’il a lu dans sa cellule, un ouvrage de Maurice Paléologue. Ce jeune homme, revenu aujourd’hui de Dachau a dit : » Pierre Brossolette était d’un calme et d’une sérénité extraordinaires, et comme détaché de tout ce qui le concernait. » A quel prix avait-il atteint ce détachement ?
Il n’attendait rien de l’au-delà. Quels sentiments ont été les siens quand lui qui n’était qu’action, jaillissement d’idées et de projets tendus vers l’avenir, il a compris qu’il n’irait pas au bout de son œuvre ? Pour ceux qui connaissaient sa prodigieuse activité d’esprit, son imagination en perpétuel travail qui s’acharnait à trouver des voies quand tout le monde abandonnait, sa volonté de lutter jusqu’au bout, ce renoncement est pathétique.
Ramené Avenue Foch le 22, il semble, d’après tous les témoignages recueillis, qu’il ait réussi à tromper la surveillance de ses gardiens : du 5eme étage, se jetant dans le vide, il se serait écrasé au sol. Il est amené à dix heures du soir à la Pitié : fracture du crâne, fractures multiples des membres ; il est dans le coma et ne reprendra pas connaissance. Il meurt à minuit. Les Allemands qui l’ont transporté à l’hôpital sous son nom, envoient son cadavre anonymement, en même temps que d’autres, au Père-Lachaise, pour y être incinéré. Impossible aujourd’hui de déterminer quelle est l’urne qui contient ses cendres.
Unité d’une vie
Pierre Brossolette nous touche de trop près pour qu’il nous appartienne de le juger. Nous voudrions seulement souligner l’unité de sa trop courte vie. Au lendemain de la guerre de 1914-1918, après de brillantes études, sa générosité le porte vers le pacifisme qui doit permettre aux nations de restaurer leurs ruines et d’évoluer dans la liberté politique et le progrès social ; il participe avec ardeur à la propagande pour la Société des Nations qu’il voudrait viable et efficace. Puis il projette ses regards sur le vaste monde, étudie le jeu des diplomates et les réactions des peuples, les tendances politiques qui se manifestent au sein des grands Mats et les doctrines économiques qui s’affrontent. Son entrée dans le parti socialiste lui vaut de prendre une part active à la vie politique française et d’en observer de près les principaux acteurs, – lui vaut aussi de combattre pour les idées généreuses qui n’ont jamais cessé d’être les siennes et qui le portent vers le peuple, pour les réformes de structure qu’il estime indispensables à l’évolution de l’état moderne dans la paix et dans la justice, pour la suppression des groupements d’intérêts et des privilèges qui ont dégradé la moralité civique en même temps qu’ils s’opposaient au progrès social « . Enfin, dans l’attitude de l’Allemagne hitlérienne qui s’est faite dans le monde le champion du totalitarisme et du racisme, il voit tout de suite une menace pour la paix. Il dénonce les abdications successives qui conduisent la France et l’Europe au conflit de 1939. Combattant, il témoigne, parce qu’il se donne tout entier à sa tâche, des qualités du véritable chef. Résistant, il manifeste dès les jours critiques de la débâcle et de l’esclavage, sa foi inébranlable dans la victoire, sa volonté d’en être un des artisans, dût-il aller jusqu’au sacrifice suprême. La victoire, en effet, n’est-elle pas nécessaire, non seulement pour libérer le sol national, mais pour instaurer un régime de paix stable et aussi une véritable démocratie qui réaliserait enfin, dans une atmosphère de probité et de clarté, les justes aspirations populaires, celles-là même qui ont permis l’accord et fait l’unité de tous les groupements de Résistance, avant même la libération de la patrie ?
Dans ses actes comme dans ses paroles, toujours la même netteté, la même droiture, le même souffle d’énergie, –la même passion aussi : cette passion qu’il se flatte de retrouver dans les sociétés, en opposition au besoin avec leurs intérêts matériels, aux époques critiques de leur histoire – une passion qui chez lui tantôt se dissimule sous la froideur ou l’ironie, tantôt éclate au grand jour en paroles parfois cinglantes, parfois émouvantes, toujours énergiques et en actes toujours raisonnés et, s’il le faut, héroïques : la passion de la liberté, de la justice, de la vérité, – la passion aussi de la France.
C’est sur cette unité de la vie de Pierre Brossolette que M. Pleven alors Ministre des Finances, qui fut son ami durant 22 ans, a insisté dans l’allocution émouvante qu’il a prononcée à la Sorbonne lors de la manifestation commémorative du 22 Mars 1945. » Sa vie, s’écria-t-il, fut celle d’un homme qui avait toujours voulu vivre comme il pensait… Je n’ai jamais connu Brossolette acceptant un compromis avec ce qu’il croyait juste ou vrai. C’était un caractère sans petits côtés, sans mesquinerie ; aucune préoccupation de carrière, d’intérêt n’a jamais obscurci son jugement, ne l’a jamais fait dévier de ce qu’il croyait la bonne voie… Jamais je n’ai connu Brossolette découragé ; en revanche, je l’ai toujours vu prêt à se dresser, à lutter contre les hypocrisies, contre les illusions, contre les mensonges. Pendant cette grande et longue épreuve de la France, beaucoup d’hommes auront, comme lui, combattu, souffert et délibérément donné leur vie. Mais il y en a fort peu, je pense, dont on pourra dire avec autant de vérité, qu’il fut uniformément, continûment, depuis l’âge d’homme jusqu’à sa fin, intransigeant avec lui-même, un modèle de rectitude et de loyauté. J’ai dit que Brossolette avait vécu comme il croyait ; c’est le deuil de la France que, pour sa délivrance, il ait fallu qu’il meure comme il avait vécu et comme il avait cru « .
Le nom de Pierre Brossolette donné à de nombreuses rues de Paris, de banlieue et de villes de province ainsi qu’à la cour d’honneur du Lycée Janson de Sailly dont il fut l’élève et au Centre National de la Radiodiffusion française à laquelle il appartint, – rappellera aux générations à venir l’exemple d’un intellectuel qui honora la pensée française, d’un journaliste laborieux et ardent, d’un historien qui préféra faire l’histoire plutôt que de l’écrire, d’un homme politique avide de liberté et de justice, d’un de ces » soutiers de la Gloire » à qui la France éternelle doit d’être redevenue indépendante, d’avoir retrouvé son âme et de pouvoir marcher vers de nouveaux destins…
C’est grâce à de tels hommes et à leur sacrifice que, selon les paroles du général de Gaulle, la Résistance française est et doit rester non seulement une force de guerre » mais un élément essentiel du Renouvellement de la Patrie dans la Paix « .
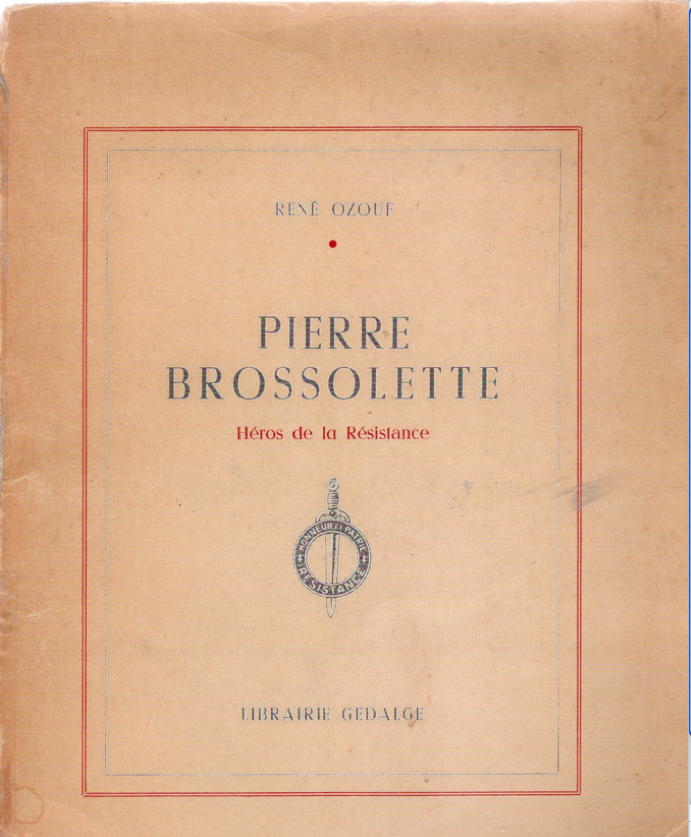
Leave A Comment