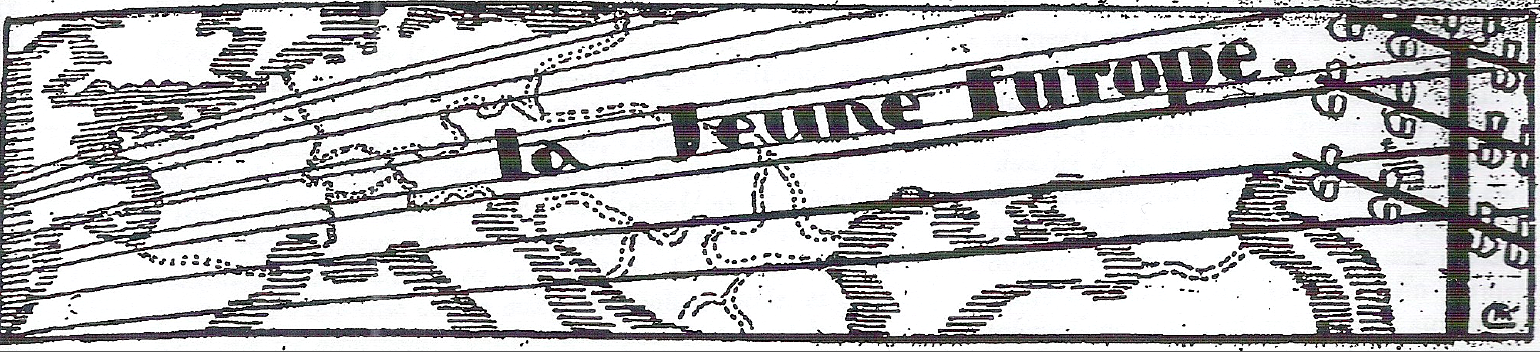
La Jeune Europe – Le mouvement international – 1er mars 1931.
Par la grâce de quelques observateurs qui nous rapportent de Moscou des révélations surprenantes sur l’économie soviétique, voici que recommence la vieille histoire des petit-boutiens et des gros-boutiens, et que nous sommes invités, de gauche ou de droite, à nous enrôler sans autre forme de procès sous la bannière des admirateurs de l’Union soviétique ou sous les drapeaux de ceux qui veulent former contre elle et contre les menaces qu’elle fait peser sur nous le front unique de la défense occidentale, bourgeoise et capitaliste.
Hier on n’avait pas assez de sarcasmes pour parler de la crise du bolchevisme, de la famine russe, de la détresse des finances soviétiques et de l’effondrement prochain de ce régime de meurtre et de folie. Nos confrères du Matin poursuivaient , dans ce sens, une campagne de dénigrement et de combat d’une rare persévérance. Et, ma foi, beaucoup de braves gens finissaient par se rendre à cette argumentation tenace et quotidienne, et par se demander après tout si cela n’allait pas en effet être bientôt la fin d’un régime qui soulève le cœur par son arbitraire, sa cruauté et son injustice.
Il apparaît qu’il n’en est rien. Les économistes qui font le voyage de Russie reviennent de là-bas avec la conviction que le développement inouï de l’économie soviétique va menacer le monde d’une effroyable crise économique. Et c’est notre éminent confrère Jules Sauerwein qui déclare dans ce même Matin à la suite de Monsieur Jean Parmentier, que le plan quinquennal mis sur pied par Staline et ses collègues a déjà réussi dans la proportion de 70 à 80% et que les Soviets sont maintenant à même de produire en telles quantités et à tels prix qu’il leur sera loisible, quand il le voudront, d’écraser tous les prix mondiaux et de provoquer la ruine immédiate de toute nos industries d’Europe et d’Amérique.
Conclusions ?
Pour le Matin et pour tous ceux qui mènent avec lui la croisade anti-soviétique, elles sont simples. Puisque les progrès d’économie soviétique constituent pour nous un péril de mort, il faut nous défendre contre eux par tous les moyens possibles et imaginables. Deux sont particulièrement préconisés. Le premier est l’élévation concertée des droits qui frappent les produits soviétiques à leur entrée dans les pays « bourgeois »: que la France, l’Angleterre, les États-Unis s’entendent pour prohiber l’importation des marchandises russes, nous dit-on, et cela suffira pour jeter bas tout le mécanisme du plan quinquennal, en laissant sur les bras des dirigeants soviétiques une masse colossal de produits invendus en même temps qu’une somme formidable de dettes intérieures et extérieures auxquelles le gouvernement de Moscou ne pourra faire face. Les esprits raffinés complètent ce premier plan de défense par un second, dans lequel tous les États bourgeois s’entendraient pour prendre en main le contrôle des importations des produits soviétiques pour les réduire le plus possible, et, en tous cas, pour ne les revendre au public qu’à des prix tels qu’ils ne menaceraient pas les industries capitalistes d’une ruine certaine.
Est-il utile de dire que les moyens seront l’un et l’autre d’une parfaite vanité et que les produits soviétiques trouveront toujours de larges fissures pour pénétrer dans l’édifice capitaliste miné et lézardé de toutes parts par les rivalités entre nations et entre particuliers ? On a déjà prix des mesures contre ce qu’on a appelé le « dumping » soviétique. Elles n’ont rien empêché. D’autres mesures n’empêcheraient rien non plus. Et l’on trouvera toujours une Italie en mal de concours politique ou des États-Unis en quête de débouchés industriels pour livrer à Moscou les clefs de la citadelle bourgeoise.
Et alors ?
Alors on nous invite, d’un autre côté à nous prémunir contre le péril russe par un grand effort d’admiration et d’amitié. On nous sert à toutes le sauces et à tous les repas des antiennes connues et d’ailleurs aussi vaines que les prédications anti-bolcheviques. On nous dit: « On ne peut ignorer un pays comme la Russie soviétique. On ne peut l’exclure de la carte du monde. Au contraire il faut en tenir compte, commercer avec elle, conquérir son amitié, et laisser à leurs regrets ceux qui n’auront pas eu l’intelligence de savoir se concilier à temps les bonnes grâces du maître du monde de demain ». Le tout agrémenté de commentaires qui font ressortir sur le mode du dithyrambe les vertus magnifiques de l’économie soviétique et du plan quinquennal exactement comme les ennemis du bolchevisme les mettaient en lumière sur le mode pathétique pour ameuter contre ses adversaires trop habiles l’opinion de l’Europe et du globe entier.
Il faut avouer qu’on ne sait pas trop ce qui est le plus irritant de cette russophile outrancière ou de la russomaquie dont font preuve les conservateurs et nationalistes de tous les pays. Merci bien pour la politique du fer barbelé et pour la rupture avec les Soviets: on n’a rarement rêvé plus totale ineptie et tentatives plus vaines. Mais, merci aussi pour les duos d’amour avec les neveux de Lénine: l’amitié des gardes rouges fera toujours à tous les gens sensés, je pense, l’effet d’une pénible duperie et d’un insupportable outrage à la justice, à l’humanité et à la mémoire des quelques millions de victimes, mortes ou vivantes, d’une des tyrannies les plus sanglantes que l’histoire ait enregistrés. Nous ne voulons ni de croisade anti-soviétique ni de croisade pro-soviétique. Le problème russe ne vaut-il d’ailleurs pas mieux que ces jugements sommaires, mieux que ces snobismes d’entichement ou d’invectives ? Ne peut-on en tirer des conclusions un peu plus positives que le bêlement ou l’injure ? C’est un effet qui ne doit pas être impossible. Et je voudrais essayer ici, sinon de le tenter, du moins de l’esquisser et de le jalonner.
Deux mots d’abord sur le plan quinquennal lui-même.
Pour nous borner aux chiffres, rappelons que c’est un plan de super-développement industriel et agricole qui doit augmenter dans des proportions considérables la production russe par rapport aux résultats de 1927-1928, résultats que les économistes soviétiques estiment sensiblement analogues à ceux de l’économie russe en 1913. Pour l’industrie l’accroissement de 160 p. 100; pour l’agriculture de 54 p. 100. La diminution des prix de revient seraient de 35 p. 100 dans l’industrie et de 4 p. 100 dans l’agriculture.
Le financement du plan exigerait en cinq ans l’investissement de 78 milliards de roubles (soit au cours officiel du change plus de 800 milliards de francs). Ce serait une erreur de croire que dans ce total, les capitaux étrangers figurent pour une large part. Au contraire, la quasi-totalité des ressources prévues sont demandées au pays lui-même. Une partie proviendra des bénéfices réalisés par les entreprises d’État sur le consommateur. Une autre de l’impôt. Une autre enfin des « ressources de la population », c’est-à-dire, des retenues forcées sur les salaires et les revenus des expropriations et des spoliations. En d’autres termes l’expérience russe – c’est son originalité la plus frappante – ne nécessite que pour une très faible part l’existence préalable de capitaux disponibles. Elle se fonde au contraire sur ce que les glossaires marxistes appellent l’accumulation du capital, c’est-à-dire, sur l’utilisation immédiate, pour de nouveaux investissements, de la plus-value, du revenu produit par les entreprises existantes. Cette accumulation du capital est évidemment prévue par les dirigeants soviétiques sur un mode accéléré: on estime à Moscou que la réalisation du plan exige une accumulation de 22 à 33,6 p. 100 par an, c’est-à-dire, que l’on doit tirer de l’économie nationale un revenu qu’on réinvestit aussitôt dans un nouveau développement de l’outillage. Est-ce une proportion impossible à atteindre ? Avec Arturo Labriola, nous croyons que non: la marge de capitaux de jouissance, de capitaux improductifs qui caractérise les régimes capitalistes étant par définition abolie en régime étatique, la formation d’un revenu utilisable de 30 p. 100 n’est pas absolument chimérique. Seulement pareille constatation doit entraîner immédiatement cette conclusion importante: c’est que l’absorption par de nouveaux investissements de toute la plus-value produite signifie ipso facto l’impossibilité de toute accroissement de la consommation individuelle. La consommation ne sera jamais qu’égale à la masse des salaires et ces salaires seront toujours, par définition, extrêmement bas puisqu’ils ne comprendront pas un atome de la plus-value produite: s’il en était autrement d’ailleurs, le taux de la plus-value, et par conséquent celui de l’accumulation du capital, serait diminué, et tout le plan serait jeté à bas.
Voilà le fait dominant de l’expérience soviétique. Il a, on le devine, des conséquences dans l’ordre intérieur et dans l’ordre extérieur.
Dans l’ordre intérieur l’impossibilité de tout accroissement de la consommation individuelle signifie tout simplement l’impossibilité de tout accroissement du bien être – individuel. Plus encore qu’en régime privé ou capitaliste l’ouvrier, le travailleur en sont réduits aux fameux salaire vital, chers à Raux. Et par suite, loin d’être la réalisation d’un régime socialiste comme on nous le répète avec horreur ou avec admiration, loin d’être la réalisation d’un régime d’économie directe et collective, le système soviétique du plan quinquennal est la réédition d’un régime qui comble peut être les vœux communs des fascistes, des jacobins et des communistes, mais qui est aux antipodes du socialisme moderne, nous voulons dire le régime étatique. Ce n’est plus le patron qui se réserve, en totalité ou en partie, la plus-value créée par le travail ouvrier: c’est l’État, c’est-à-dire, une entité dépourvue de la moindre signification si elle ne s’identifie plus à la collectivité.
L’État soviétique – en nous en arrivons là au domaine extérieur -, ce n’est pas la collectivité soucieuse de se procurer à elle-même, de procurer à tous ses membres, plus de bien-être et de bonheur. C’est un mécanisme formidable destiné à faire produire au pays une masse formidable de marchandises uniquement destinées à inonder le marché extérieur, à noyer le monde capitaliste. C’est le nationalisme le plus complet, le plus absolu qu’on puisse rêver, puisqu’il réserve à la lutte étrangère la totalité de ce qui n’est pas indispensable à le vie élémentaire des citoyens.
On comprendra, dans ces conditions, que je refuse de me pâmer de plaisir et d’admiration devant ce régime qui est la négation du socialisme et la magnification des deux conceptions les plus opposées au socialisme, le nationalisme et l’étatisme. J’ajoute que le système est à la portée de tout le monde, et qu’il ne suppose pas, comme le capitalisme, des capitaux préexistants, ni même, comme le socialisme, une prospérité préétablie. Le jour où les plus misérables fellahs voudront s’y mettre, il ne tiendra qu’à eux: il leur faudra simplement à manger un peu moins pour que l’État de leurs rêves accumule un peu plus et alimente lui aussi son plan quinquennal.
La question de sympathie et d’admiration mise à part, quelle attitude adopter devant cette menace russe ?
Disons tout de suite que nous ne sommes pas absolument convaincus que les produits russes soient actuellement ou prochainement imbattables sur le marché mondial. La production est relativement chère en U.R.S.S., la qualité demeure très médiocre et notre excellent camarade Marion a très judicieusement mis en lumière les incontestables points faibles de l’économie soviétique. Le péril russe n’est donc peut-être pas aussi certain, aussi mathématique que nous le disent à la fois les ennemis et les zélateurs de Moscou, les uns pour nous faire peur, les autres pour nous amener à composition.
Admettons cependant – il le faut – que ce péril existe et qu’il soit grave. Pour y parer il faudra bien admettre un effort de restriction et de privation des nations menacées par l’économie soviétique. Cet effort, les masses y seront appelées, en dernière analyse, à le supporter. Y consentiront-elles ? Bien hardi qui le dirait. Mais ce qu’on peut dire dès maintenant avec certitude c’est qu’elles n’ont de chance d’y consentir qu’à un certain nombre de conditions.
D’une part, elles n’admettront pas que subsiste, en cette époque prévisible de pénitence, le prélèvement du profit réalisé par le patrons sur les travailleurs et elles n’admettront pas non plus que leur effort soit destiné, s’il réussit, à assurer le salut d’une société dont elles ne sont pas les bénéficiaires, alors qu’elles en sont la substance même.
D’autre part, elles n’admettront pas que leur effort soit accru par des charges absurdes de préparation à la guerre et de rivalités nationales.
C’est-à-dire qu’il n’y a de lutte possible contre le dumping russe que par la paix européenne et la gestion des collectivités par elles-mêmes.
À cette double condition l’Occident peut prévaloir sur l’Orient, dont l’étatisme dictatorial n’est tout de même qu’une forme rudimentaire, onéreuse et intolérable de la vie sociale – mais à cette double condition. L’économie dite libérale ferait bien d’y songer.
Leave A Comment